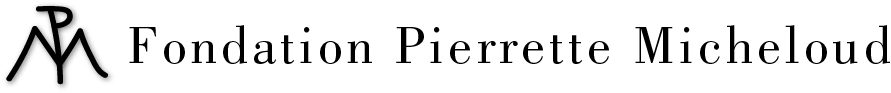Bonsoir,
S’il est des poétiques fondées sur le refus, la rupture, la négation, celle de Richard Rognet, lauréat de notre Prix 2018 pour son livre «Les frôlements infinis du monde», en est bien éloignée.
En effet, tout, dans sa poésie, cherche à tisser des liens, avec le passé, le présent et le futur; avec tout ce qui l’entoure; avec les autres et soi-même.
Dans la poésie française actuelle, je vois peu d’œuvres qui dégagent une telle présence au monde (et c’est sans doute ce que veut nous dire aussi le titre de ce nouveau livre).
A ce propos, j’ouvre une parenthèse: vous serez peut-être intéressés de savoir que Richard Rognet emprunte en général le titre de chacun de ses livres à un poème de l’ouvrage qui l’a précédé. C’est ainsi que l’on peut lire dans «Dans les méandres des saisons», de 2014, à la fin d’un texte consacré aux oiseaux, que ceux-ci chassent «les encombrantes / tristesses, les regrets qui s’infiltrent / partout, les idées noires et la crainte / de ne pas pouvoir reconnaître, parmi mes / phrases, les frôlements infinis du monde.»
Poésie de la célébration, donc. Mais loin des grandes orgues de Claudel ou Saint-John Perse, c’est plutôt le chant d’un hautbois que l’on croit percevoir.
La nature célébrée est celle qui depuis toujours constitue le paysage de Richard Rognet, cette région des Vosges où il est né et qu’il n’a guère quittée, à ce qu’il semble.
Ce livre palpite de vie: ce sont les sources, les montagnes, les forêts. Le vent y répond à la neige, les étoiles aux étangs, les nuages aux champs.
Comme avant lui Messiaen ou le Poverello d’Assise, notre poète a la passion des oiseaux, qui semblent s’envoler d’un livre à un autre.
Parfois, leur présence est seulement signalée par une notation un peu vague, tel cet arbre qui «se réjouit du passage / des oiseaux dans ses branches» ou «la rosée matinale / où s’abreuve un oiseau»; ailleurs, ce sont «les restes lumineux d’un ramage / d’oiseaux».
Mais pour bien connaître, il faut savoir nommer, avec précision. Qui prétendrait ne pas connaître le nom de ses amis?
C’est ainsi qu’apparaissent la mésange et le pinson, l’hirondelle et le merle, le corbeau et le rouge-gorge.
D’autres animaux aussi font partie du décor: la vache et le chat, la taupe (désignée uniquement par son habitat), les abeilles, papillons et autres insectes.
Comment ne pas penser à Pierrette Micheloud et ses «Seize fleurs sauvages à dire leur âme» quand tant d’entre elles jalonnent ces pages? Elles se nomment rose ou géranium; lilas, pervenche, bruyère, épilobe; gentiane, jonquille, crocus, pissenlit; coquelicot, pâquerette, iris et même, pourquoi pas?, orchidée.
Les arbres ont nom pin, hêtre, tilleul, bouleau, sapin. Ce sont comme des frères. Le poète n’écrivait-il pas dans «Dans les méandres des saisons»: «mieux vaut / étreindre un arbre, n’écouter que lui — se taire»?
Toutes ces manifestations, parfois infimes, du monde auquel nous appartenons sont peut-être notre bien le plus essentiel: «revenons / au chat, aux feuilles, ils sont d’ici, / ne soyons pas plus qu’eux, disons-nous / que le peu qu’ils proposent / est le sommet précieux de notre destinée.»
Vœu de pauvreté, d’humilité — voilà qui nous ramène encore à saint François.
Le poète peut se sentir si proche de la nature qu’il va jusqu’à écrire dans «Elégies pour le temps de vivre»: tu prends / les sources contre toi, tu les fais / courir sous ta peau, dans ta chair, / comme autant de nouveaux vaisseaux».
Fort est son besoin d’enracinement, dans une terre, dans une histoire familiale, ancestrale, dans l’univers. Il l’exprime souvent, ainsi dans ce dernier livre: «tu sais / qu’en toi les saisons s’enracinent». Plus loin c’est «une exubérance / de parfums, de reflets, de couleurs, / où semblait prendre racine / l’immensité du monde.»
Ce monde, il le sait aussi en péril, comme le remarque judicieusement Béatrice Marchal, qui nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir, en pressentant un «sentiment de catastrophe générale.»
Tout n’est évidemment pas rose dans la vie du poète. Il confesse même: «je suis obscur, je m’en excuse». Ailleurs il évoque «une ancienne blessure». Il parle de lui en ces termes: «moi qui ne saurai jamais / comment vivre s’écrit».
Dans l’un des derniers poèmes du livre, on pourrait voir comme un possible constat d’échec et le texte se termine par cette interrogation lancinante: «Qu’aurait-il donc fallu?»
C’est notamment grâce à notre jury, qui se compose, je vous le rappelle, outre moi-même, de Mme Catherine Seylaz-Dubuis et MM Jean-Dominique Humbert et Ferenc Rákóczy, que j’ai le plaisir d’accueillir ce soir Richard Rognet.
Jean-Pierre Vallotton, président du jury