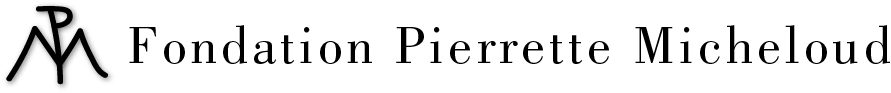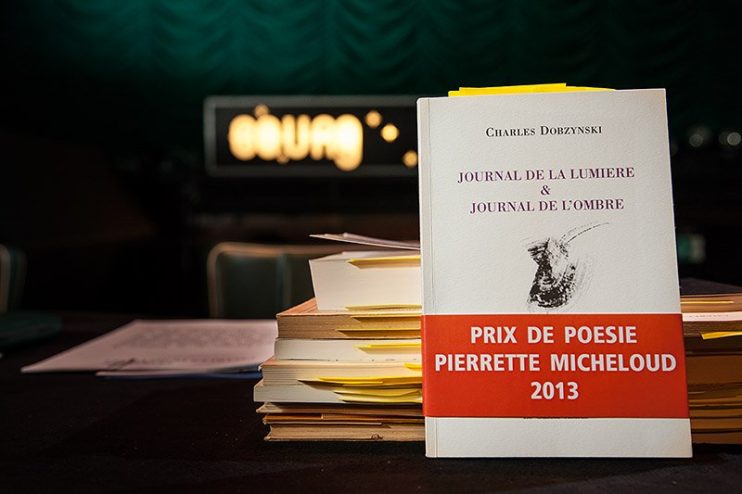2024
Non-attribué
2022
Muriel Pic, pour L’argument du rêve (Editions Héros-Limite, Genève)
Le Jury de la Fondation Pierrette Micheloud (qui se compose de Nuria Manzur-Wirth, Jean-Dominique Humbert, Ferenc Rákóczy et moi-même) a porté son choix sur un livre singulier, qui se démarque du traditionnel recueil de poèmes, et bouscule les genres, selon une structure assez complexe, comme c’était déjà le cas pour notre lauréat précédent, Antonio Rodriguez, avec « Europa Popula ».
Y aurait-il du nouveau sous le soleil ?
L’idée peut se faire jour qu’une nouvelle forme de poésie est en train d’émerger, qui ne se réclame encore d’aucune école, mais qui va sans doute nous offrir encore d’autres ouvrages remarquables.
Il n’est évidemment pas question ce soir d’ébaucher une nouvelle théorie poétique et je devrai me contenter de relever certains aspects de « L’argument du rêve » de Muriel Pic.
Je parlais à l’instant d’une structure complexe. Voyons en quoi elle consiste.
La première chose qui nous frappe en feuilletant « L’argument du rêve » est de constater qu’un grand nombre de pages (presque un quart du livre) est dévolu à des photographies et documents divers. On se rendra vite compte qu’il ne s’agit pas là de simples illustrations mais d’éléments importants de l’ouvrage : texte et images s’interrogent mutuellement, en donnant au lecteur des clefs ou en prolongeant le rêve.
Après une introduction d’une très grande richesse, l’ouvrage se divise en trois parties ou rêves — celui de Sei Shônagon, écrivaine japonaise du Xe siècle ; celui de la poète allemande du XIXe Annette Droste-Hülshoff ; et celui du poète et photographe américain Robert Lax, décédé en 2000, à l’âge de 84 ans.
Ces différents rêves sont prophétiques car ils évoquent des événements historiques postérieurs à l’époque de la rêveuse. Pour la première : la résistance kamikaze à l’armée américaine imposée aux habitants de l’île nipponne d’Okinawa en 1945. Pour la deuxième : la vie d’une collectivité naturiste et idéaliste durant l’avènement du nazisme. Pour Lax, c’est le drame des réfugiés péris en mer entre 1940 et 2017.
Or, nous n’en restons pas là. Chacune des trois parties se ramifie tel un delta. Ainsi Okinawa mène à Fukushima en passant par Hiroshima, la Guerre du Vietnam, la caméra de Chris Marker ou encore le procès de l’écrivain japonais Kenzaburō Ōe.
Dans la deuxième partie Muriel Pic n’hésite pas à faire apparaître aussi bien l’anarchiste Bakounine que le philosophe au tonneau Diogène, la cinéaste du 3e Reich Leni Riefenstahl ou le peintre renaissant Ghirlandaio, une liberté et une érudition dignes d’un film de Godard.
Avec Lax et les naufragés, sept vagues viennent s’échouer sur la page en évoquant Villon, Whitman, Sapho, Brecht, Hölderlin…
On peut donc dire que le temps circule à travers le livre de façon non-linéaire.
Il y est beaucoup question d’îles : l’archipel du Japon ; Orplid, île imaginée par le poète Eduard Mörike ; Patmos où se retira Robert Lax, sans jamais rencontrer le poète franco-hongrois Lorand Gaspar et son ami le poète grec Georges Séféris qui y séjournaient fréquemment.
Le texte, présenté dans l’introduction comme « un oratorio photographique en vers libres » est émaillé de citations, qu’il s’agisse de poèmes ou d’extraits de documents officiels.
Le propos du livre, selon cette même introduction, serait « de restituer un film de vies anonymes et de documents humains ». On peut en effet imaginer que Muriel Pic a peaufiné son livre comme un cinéaste son film dans la salle de montage — et ce n’est pas par hasard qu’Alain Resnais (qui avait débuté dans la profession comme monteur en 1945, ou presque : il avait fait de la figuration trois ans plus tôt dans « Les visiteurs du soir » de Prévert et Carné) est évoqué à travers le titre d’un de ses films (certainement le plus ouvertement politique de tous), « La guerre est finie » — et nous savons bien qu’elle ne le sera jamais. La triste actualité est toujours là pour nous le rappeler.
De même qu’il existe au cinéma des docufictions (déjà à l’époque du muet, Flaherty demandant à Nanouk l’Esquimau de reproduire devant sa caméra ses activités habituelles sur la banquise), il pourrait y avoir en poésie une catégorie de docupoèmes, dont ferait partie « L’argument du rêve » ou « Le naufrage du Titanic » d’Enzensberger (paru en 1978). On pourrait même remonter jusqu’au début des années 1920 avec les « Poésies documentaires » de Mac Orlan, où il parle notamment de la réjouissante « Elégance de tout rater ».
Dans son livre foisonnant, Muriel Pic n’hésite pas à détourner le discours de Descartes en affirmant : « Je rêve, donc je suis ».
Son livre qu’elle se plaît également à présenter comme « un rêve argentique » — en référence sans doute aux nombreuses photos d’époque qui le ponctuent et aux autres, innombrables, qu’elle a dû compulser dans différentes archives pour faire une partie de son miel.
Sa lecture terminée, le lecteur n’aura probablement qu’un désir, celui de la recommencer.
Ou encore de se prêter au jeu que nous suggère, entre les lignes, Muriel Pic : dans la section intitulée « Mes fantômes (par ordre d’apparition » – pour un fantôme, le mot est bien trouvé -, tel le générique défilant à la fin de certains films, il s’agirait de retrouver les passages du livre correspondant à ces différents fantômes, de Lucrèce à Giotto. Je défie quiconque de tous les identifier au fil des pages. Nous n’aurons pas tous fait le même rêve en lisant ce livre. C’est aussi ce qui le rend très attrayant.
Ces deux pages de fantômes sont suivies d’une dernière avant la « Table des rêves », « Crédits à l’état de veille » : références des archives consultées et remerciements d’usage. On le voit, l’humour est loin d’être absent de ce livre.
J’aimerais aussi me pencher sur l’infralyrique qui donne son titre à l’introduction.
Mais pour cela, j’ai le plaisir d’inviter Muriel Pic à me rejoindre.
Jean-Pierre Vallotton
C’est avec beaucoup d’émotion que j’adresse mes remerciements à la Fondation Pierrette Micheloud et à son jury pour le prix de poésie attribué à mon ouvrage L’Argument du rêve, publié aux Editions Héros-Limite en 2022. Je partage avec mes éditeurs Alain Berset et Gaia Biaggi cet honneur : L’Argument du rêve est un livre qui travaille avec des archives photographiques inédites, le montage entre les textes et les images ne s’accomplissant qu’avec la complicité de ceux qui fabriquent le livre.
Il est rare qu’une émotion vive, quelle qu’elle soit, vous laisse en paix la nuit. L’émotion cherche toujours à se faire une place dans nos rêves. Elle invente des images et des histoires étranges qui font lever en nous des fantômes et des fantasmes, des souvenirs et des désirs. C’est pourquoi, j’aimerais à présent vous raconter le rêve ou la rêverie littéraire qu’a fait surgir en moi la nouvelle du Prix Pierrette Micheloud. Ce rêve est survenu après une promenade dans le Valais, dont Micheloud est originaire, et où elle a fait durant les années 1950 des tournées estivales à bicyclette pour lire ses poèmes d’un village valaisan l’autre, à la manière des troubadours.
Outre cette promenade, il faut savoir aussi que le soir où j’ai fait ce rêve, je me suis endormie en lisant la section de 1859 des Curiosités esthétiques de Charles Baudelaire, mes yeux se fermant sur un passage fameux de l’essai Le public moderne et la photographie. J’emportais avec moi dans le sommeil ces lignes de Baudelaire, lues pour la énième fois, qui m’ont donné il y a longtemps le désir d’une poésie documentaire, mais non pas en abondant dans leur sens, bien plutôt en allant à contre-courant. Je vous lis ce court passage : Que la photographie enrichisse rapidement l’album du voyageur et rende à ses yeux la précision qui manquerait à sa mémoire, qu’elle orne la bibliothèque du naturaliste, exagère les animaux microscopiques, fortifie même de quelques renseignements les hypothèses de l’astronome ; qu’elle soit enfin le secrétaire et le garde-note de quiconque a besoin dans sa profession d’une absolue exactitude matérielle, jusque-là rien de mieux. Qu’elle sauve de l’oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes et les manuscrits que le temps dévore, les choses précieuses dont la forme va disparaître et qui demandent une place dans les archives de notre mémoire, elle sera remerciée et applaudie. Mais s’il lui est permis d’empiéter sur le domaine de l’impalpable et de l’imaginaire, sur tout ce qui ne vaut que parce que l’homme y ajoute de son âme, alors malheur à nous !
Cette malédiction, je l’ai faite mienne. Sans doute car, à mes yeux, et paradoxalement, ces lignes sont le plus bel hommage que l’on puisse faire à la photographie et au lyrisme documentaire. La malédiction qu’elles annoncent est aussi un témoignage extralucide sur la puissance épiphanique de la photographie. Baudelaire a compris immédiatement que l’invention la plus récente de son temps avait ouvert un passage vers l’imaginaire le plus archaïque, que la plus exacte des techniques nous faisait soudain pénétrer dans ce domaine de l’impalpable où séjournent les mânes. J’ai depuis longtemps formé l’hypothèse que Baudelaire (dont il ne faut pas oublier qu’il fut très ami de Nadar, le plus grand photographe de son temps) s’insurgeait contre la photographie, justement pour nous prévenir qu’elle était une nouvelle porte ouverte sur le Royaume des morts. La photographie est, comme le rêve, un passage entre les siècles.
Mais il est temps d’en venir à mon rêve de Pierrette Micheloud.
Un jour de grand soleil, je suis en promenade dans la montagne, le couple poumon-cœur en action, pleine du courage élémentaire que suscite la pente et concentrée sur l’effort qu’elle demande. Je veux m’abandonner à l’exaltante élévation, mais je manque soudain de force. Prise de ramollissement sous la chaleur du soleil, je m’arrête à l’ombre d’un mélèze sur un rocher dont l’aplat semble s’offrir au plaisir de la halte. A peine ai-je repris mon souffle et calmé les battements de mon cœur que je vois surgir au détour du sentier une femme à bicyclette. Elle porte un vêtement de papier Canson éclatant sous le soleil et couvert d’inscriptions tracées à l’encre de Chine, parmi lesquelles je reconnais des fragments de grec ancien sans parvenir à déchiffrer le sens. Elle porte par-dessus cet improbable habit de mots magiques une cravate à motif liberty et un gilet sans manche noir à la manière des hommes. Sans paraître faire le moindre effort, lévitant plutôt qu’elle ne pédale sur le chemin escarpé, elle arrive jusque vers moi, pose le pied à terre, enlève un casque invisible, secoue ses cheveux bruns et courts avec le sourire de ceux qui connaissent le bonheur et l’injonction vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Je constate que la bicyclette a des ailes et qu’elle porte un nom : Alcyon. Tout en observant avec bienveillance ma stupéfaction au travers de ses lunettes larges et ovales, elle s’adresse à moi avec un air déterminé et se présente : je suis Pierrette Micheloud, j’ai une nouvelle pour vous. Je la regarde les yeux écarquillés. Oui, j’ai une nouvelle pour vous… Elle ouvre alors les bras vers le ciel et, après avoir salué le mélèze comme un vieil ami, s’exclame avec ardeur : venez ma revenante ! Ne vous arrêtez pas sur votre ombre et méditez avec moi. Savez-vous que votre âme est une grande forêt qu’il faut défricher de ses ronces pour arriver à une clairière qui baigne dans une telle lumière que l’on dirait un lac de montagne ? La surface est un miroir argenté dans lequel on se reflète, et dans lequel le soleil aussi se reflète, si bien que l’on peut y voir un point de folle lumière. C’est le point de conscience. Et plus l’être humain va vers ce point lumineux, et plus il se sent seul face au monde ; et plus l’être humain s’approche de ce point de lucidité, et plus il arrive à se réaliser lui-même ; et plus l’être humain va vers sa conscience, et moins il est seul… car il s’est enfin compris. Venez ma revenante ! Et apprenez votre histoire naturelle : dans une ruche, il y a une reine, dont le rôle est de pondre, et il y a des milliers d’ouvrières qui travaillent pour le miel et sa lumière. Dans le monde, c’est le contraire : il y a des millions de reines qui sont là pour procréer, et seulement quelques ouvrières, qui sont là pour faire un autre travail, un autre miel, le poème. Venez, ma revenante ! Et surtout ne donnez jamais vos livres. Vendez-les plutôt car donner un livre, c’est obliger quelqu’un à le lire, et ce n’est pas dit que cela soit une source de plaisir. Il en va tout autrement quand quelqu’un achète un livre, il le fait seulement pour lui, pour retrouver une phrase, un poème, quelques lignes, une émotion. Venez ma revenante ! Et soyez pleine de contradictions, soyez féminine et masculine, soyez une misanthrope qui souffre à la place d’autrui jusqu’à l’intolérable, soyez cette âme qui s’arrache de son corps, s’arrache à tout ce qu’elle connaît et se jette dans la peau d’autrui sans jamais craindre de ne plus en sortir. Venez ma revenante ! Venez, jetez-vous-en moi et n’en revenez pas. Car j’ai une nouvelle pour vous…
Avant même que je puisse réagir ou répondre, un homme au front haut, en costume noir et cravaté de rouge sanglant apparaît au milieu du paysage qui s’élargit à chacun de ses pas en un grand mouvement entièrement silencieux. Tout change de proportion, se métamorphose, le flanc des montagnes, le lac brillant derrière, les troupeaux qui paissent un peu plus bas, le val d’Hérens, la cabane Rossier et les arêtes de la Dent Blanche. Tout se modifie, se déplace, se transforme en un tableau aux géométries impossibles et idéales. A chacun de ses pas, Charles Baudelaire creuse un nouvel abîme. Au fur et à mesure qu’il s’approche, laissant derrière lui le souvenir des choses terrestres, une ombre géante s’étend et arrive bientôt sur nous. La scène m’évoque un rituel d’adombration où le corps physique d’un disciple, la plupart du temps un initié qui a été préparé de longue date pour cette occasion, reçoit les enseignements spirituels qui lui permettront de poursuivre le travail du maître. La Puissance du Très–Haut te prendra sous son ombre. Mais Baudelaire chasse les Évangiles de la main, dissipe l’ombre et profère une malédiction : Ah ! Malheur à nous ! Il est vrai que celui ou celle qui écrit jouit d’un dangereux et incomparable privilège. Il peut à sa guise être lui-même et autrui. C’est une âme errante qui cherche un corps, et puis un autre. Il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Cependant, il ne fera rêver personne ni n’étonnera quiconque s’il jette son âme dans une photographie. Si une telle chose devait se produire, alors malheur à nous ! Car c’est une faute de talent que de chercher à étonner le public avec un document. Une photographie n’est rien d’autre que le résultat d’une technique qui saisit le spectateur comme elle saisit un visage, grâce à un déclic mécanique. L’étonnement qui en résulte est certes spectaculaire, mais si pauvre en comparaison de ce qui est le but de l’art véritable : faire rêver le public.
Pierrette Micheloud est elle aussi bien forcée de l’admettre : la technique a pris le pas sur l’art. Heureusement, Sappho a existé et je ne suis jamais seule. Elle me demande ce que j’ai souffert et pourquoi je l’appelle, et je lui réponds : revenez ma revenante, j’ai toujours une nouvelle pour vous.
Je ne puis alors m’empêcher de penser à mon tour. L’étonnement poétique n’est pas l’étonnement médiatique. Le premier est le prolégomène de toute démarche philosophique, il est le premier pas de l’esprit critique. Critiquer veut dire prendre de la distance en se rapprochant, ce qui n’est pas un paradoxe : on le fait spontanément pour mieux voir, quand on veut observer une chose plus en détail, ou écouter avec davantage de précision. Dans le silence d’un chemin de montagne, dans le ressac de la mer sur la plage, on tend le regard comme on tend l’oreille pour saisir l’imperceptible qui nous dépasse en nous liant à une autre vie qui nage ou rumine. On s’approche plus près, on prend un risque, on se met en danger, on perd bientôt l’équilibre, et on se jette finalement dans une vache ou un coquillage, dans une image, un fantôme, un fantasme. On s’étonne alors, et on rêve aussi, entièrement absorbé par un détail, bien davantage sans doute que par une vue large et globale. Le particulier nous requiert, l’accroc d’une maille raconte une journée, le regard d’une bête est une révélation. Je parle de ce qui ne parle pas, des muets témoins, des poux, des singes, des cigognes au ventre blanc et des léopards en trophée, de l’animal anonyme et du cœur des éléphants. Je parle de ce qui ne parle pas, des archives et des photographies, des traces et des sillages, de ceux qui ne sont plus là et de ceux qui ne sont pas encore nés.
Sur ces mots, je me réveille devant vous, et je reçois finalement la nouvelle de Pierrette Micheloud, nouvelle qui m’honore d’un prix de poésie, ce dont, infiniment ce soir et avec émotion, je vous remercie.
2021
Antonio Rodriguez, pour Europa Popula (Editions Tarabuste).
Notre Jury, qui se compose de Catherine Seylaz-Dubuis, Jean-Dominique Humbert, Ferenc Rákóczy et moi-même, a donc décidé d’attribuer le Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2021 au livre d’Antonio Rodriguez, Europa Popula.
Disons-le d’emblée, ce n’est pas une œuvre que l’on peut se contenter de lire une seule fois (mais qui prétendrait avoir tout assimilé après une première écoute d’un quatuor à cordes d’Alban Berg ?).
Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore lu Europa Popula (ou ne l’auraient lu qu’une fois), essayons d’en dresser une topographie (provisoire, évidemment, même s’il ne s’agit pas de la cité fantôme de Robbe-Grillet).
Le livre s’ouvre sur un hommage (posthume) à Antoine Emaz (peut-être ce maître en poésie évoqué à la fin de l’ouvrage).
Page de droite suivante, on trouve une citation de Yeats, non traduite.
Les pages 11 à 13, en italique (comme les textes qui suivent les chapitres et les indications que l’on trouve au bas des pages de droite, sortes de titres, ou sous-titres, a posteriori), forment comme une ouverture, au sens opératique.
Puis le livre se divise en (appelons-les comme cela) sept chants titrés, chacun étant suivi d’une… dirons-nous coda ?
Remarquons en passant le chiffre sept qui n’est pas anodin. Dans le Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheerbrant, il nous est rappelé que dans presque toutes les religions et mythologies, il représente «une perfection dynamique», «la totalité de l’univers en mouvement», et qu’il est par ailleurs «caractéristique du culte d’Apollon», la lyre comportant également sept cordes.
Europa Popula est aussi le troisième volet d’une trilogie, je dirais plutôt triptyque,— et voilà le nombre trois, qui n’est pas moins chargé d’un symbolisme immémorial et planétaire, souvent lié à la spiritualité, aux trois phases de l’existence : apparition, évolution, destruction (ou transformation), parfois aussi à des rituels magiques.
Si j’ai choisi le mot triptyque, c’est que, à l’instar des œuvres de Brueghel (longuement évoquées dans le livre d’Antonio Rodriguez), ces textes offrent une vue d’ensemble foisonnante, composée de multiples éléments (telles des notes de musique qui cascadent dans une partition), parmi lesquels se dissimule le motif principal (dans les œuvres du maître flamand, rappelons: Joseph et Marie dans un paysage hivernal; la pie sur le gibet; ou encore la chute d’Icare dont on ne discerne plus que les jambes et quelques doigts s’enfonçant dans la mer et des plumes qui virevoltent).
Le lecteur en saura-t-il davantage sur l’Europe après avoir lu ce livre (ou les trois)?
Je serais tenté de répondre qu’il connaîtra surtout mieux la sensibilité artistique de son auteur et sa virtuosité à composer un livre qui n’est ni un poème, ni un récit, ni un essai, et pourtant tout cela à la fois.
Qu’est-ce qui en rend la lecture en même temps harmonieuse et complexe, musicale et dissonante?
La composition d’un tel livre se rapproche sans doute beaucoup du travail que l’on effectue lors du montage d’un film (disons d’Eisenstein ou de Resnais), sorte de puzzle à la façon du Je t’aime, je t’aime de ce dernier.
Rodriguez procède par glissements continus et furtifs d’une strate à une autre du livre: celle d’événements historiques; celle (mais ce n’est qu’une hypothèse difficilement vérifiable) de souvenirs personnels de l’auteur; celle du rêve et des phantasmes ; celle d’œuvres d’art identifiables (Brueghel, nous l’avons dit, mais aussi Klimt, dont le narrateur fait entrer dans son phantasme, «la mariée» qui «dort contre [son] flanc» — et il n’est pas inintéressant de remarquer que, parmi tant d’autres, il choisit une figure féminine d’un tableau inachevé, l’un des derniers du peintre autrichien, rendant cette rencontre érotique encore plus mystérieuse et improbable,— fantôme de rencontre; la strate enfin d’un récit fictionnel avec des «personnages» (cette énumération n’étant pas exhaustive).
Les premiers mots occupant toute une page du premier volume du triptyque sont: «non, c’est une fiction
Prologue».
Nous voilà donc prévenus. Ou leurrés. L’auteur n’écrit-il pas par ailleurs que son livre «se construit comme un récit impossible»?
Quant au statut de ses présumés personnages, il est aussi peu explicite que dans les romans de Nathalie Sarraute.
Ainsi dans la partie intitulée Ma chambre au Belvédère, les trois femmes suscitant un magnifique lyrisme érotique sont-elles nommées simplement: rousse, brune, blonde.
Pour mieux les approcher, il conviendrait de faire une étude serrée sur l’emploi des pronoms personnels dans Europa Popula. Rodriguez en fait un savant jeu de pistes embrouillées.
Ce n’est pas par hasard qu’un chapitre de son livre s’intitule Dans le labyrinthe du continent (et revoilà l’ombre de Robbe-Grillet).
Le premier texte commence par: «ˮnonˮ, ils disent ˮnonˮ» (c’est donc le deuxième livre qui débute sur cette négation: non).[1]
Quelques lignes plus loin il est question de nos corps, très vite suivi de «je retrouve le calme de ma chambre». Plus bas survient «si tu peux l’entendre».
Le paragraphe suivant nous explique le rôle des différentes chambres évoquées dans le livre: «ici, ˮchambreˮ désigne la transition des époques, le franchissement des murs, l’infiltration par les fleuves, l’exploration des reflets, l’enchevêtrement des pièces, des lieux, des villes, des femmes, des enfants et même des cris, passant à peine à travers l’encombrement, ne sachant plus exactement de quel temps nous provenons si ce n’est cet entre-deux-guerres».
La fin du texte revient au je, qui nous dit: «je respire avec toi, poésie» (était-ce elle déjà dans le premier tu cité?), puis «avec ce qui flambe déjà devant nous», les «peuples déçus qui se dirigent vers le ciel aveuglant» (était-ce déjà eux qui disaient non en ouverture? Probablement).
Ces quelques remarques, vous le voyez, suscitent de nombreuses questions.
Et des questions, justement, je vais en poser d’autres à notre lauréat.
Je suis très heureux d’accueillir Antonio Rodriguez.
Jean-Pierre Vallotton,
président du Jury
[1] C’est moi qui souligne tous les pronoms et possessifs.
Je suis très touché de l’honneur que me fait la Fondation Pierrette Micheloud en m’attribuant son prix de poésie 2021. Ce prix est important en Suisse, et j’en suis d’autant plus heureux qu’il salue un recueil, Europa Popula, qui est certainement l’ouvrage le plus complexe et le plus exigeant (en termes de lecture, tout du moins) de la trilogie consacrée à l’Europe.
Je salue l’audace de ce jury, qui a porté son intérêt sur un livre de poésie un peu étrange, qui commence dans une salle d’accouchement, avec le regard d’un homme sur une nativité cosmique, au ralenti, et qui aboutit aux derniers moments de la vie, dans une chambre de mort avec un robot infirmière, qui devient une nouvelle Dame de la poésie. Entre ces deux seuils, l’ouvrage déploie une poésie des amours tristes dans un abri antiatomique, un tourbillonnement au centre du continent, à Vienne, que ce soit par le cycle des souffrances chez Bruegel l’Ancien ou celui des extases érotiques chez Klimt, et il en vient à deux sections qui évoquent le carnaval du populisme dans un régime nommé Popula, où chacun essaie de survivre. Mais bien plus que les thèmes, c’est la langue elle-même et l’écriture qui, sous des apparences souples, assez immédiates, se révèle complexe techniquement, labyrinthique syntaxiquement, et, je l’espère, savoureuse émotionnellement.
Je dois vous avouer que je ne m’attendais pas à recevoir ce prix pour Popula. À la sortie de l’ouvrage en octobre 2020, nous abordions la deuxième vague de la pandémie Covid. Tous les événements consacrés à l’ouvrage ont été annulés à l’automne, notamment au Marché de la poésie, puis au printemps. Et j’étais dans un tel état, que je n’avais plus l’énergie pour m’occuper de la promotion, ce qui est un moment décisif. Je n’avais pas envie de l’envoyer, pas envie de courir après les comptes rendus, pas envie de chercher à le faire connaître. Je me suis alors adressé à mon livre en lui disant ceci: «Excuse-moi, je ne vais pas pouvoir m’occuper de toi comme tu le mérites, il faut que tu apprennes à vivre par toi-même. C’est toi qui vas mener ton propre chemin, et je vais simplement t’accompagner.» C’est pourquoi, ce soir, je tenais à remercier cet objet chargé d’énergie, ce livre, qui a pris en main son propre chemin, et qui m’amène ici devant vous.
Je parle de mon livre comme d’un objet organique, parce que je travaille chaque poème comme un noyau d’énergie, j’essaie de capter des flux, des voix, des couches de vie. Je travaille en plaque sensible, hypersensible, et je capte tous ces flux, surtout lorsque je suis fatigué le soir ou pendant la nuit. Alors quelque chose se passe, qui préfigure les poèmes. Mon écriture est centrée sur la matière, ses mouvements souterrains, ses joies à croiser, combiner, croître, et ses refroidissements, ses déchirures, ses fragmentations nécessaires. Les noyaux, les énergies, les déflagrations, les fusions, la lave qui déborde me fascinent; la matière se reprend sans cesse, et la langue doit parvenir à la dire.
Je suis aussi hanté par les guerres modernes en Europe, hanté par les cendres, ce sol chargé de vies, et les couches de joies ou de souffrances de plusieurs générations, je suis hanté par leurs désirs déçus, les espoirs perdus, par les larmes, les appels au sens, parfois par la révolte — je les entends. En même temps, je me sens ancré et ouvert sur mon époque, serein, partageant ma vie avec mes contemporains, essayant de la savourer au mieux. Je trouve notre temps exaltant, tendu, intense, brutal et rêvant encore, parfois naïvement, d’idéal: à la surface, tout semble aller très vite, mais en dessous tout est lent, tout rechigne, tout a peur, et avance avec peine. Je m’occupe de ce temps lent. C’est pourquoi j’ai forgé une sorte de livre des mutations, des psalmodies comme des rites, afin de nous encourager.
Je me sens incroyablement lié aux poètes, aux acteurs de la poésie de notre époque, sur différents continents, mais aussi aux artistes, qui cherchent des voies dans le tumulte. Au début de notre rencontre, vous avez pu voir le travail «Responsive Europa» de typographique dynamique, réalisé avec Demian Conrad pour une biennale de design en 2019, en plein Brexit, à partir d’un de mes poèmes qui simule un générateur de texte sur le mot «Europe». À la fin, vous pourrez voir le clip de Yannick Maron à partir d’un poème de Popula. Notre époque est fascinante dans le passage du livre au numérique, au multimédia, dans les refontes politiques, dans les nouvelles échelles mondiales, transnationales.
Certains diront que notre époque est dangereuse, mais toutes les époques le sont, et toutes révèlent leur splendeur, souvent après coup. Pour moi, notre époque est aussi dangereuse que merveilleuse, merveilleuse parce que dangereuse, et je ressens l’opportunité inouïe qui m’est donnée de la parcourir poétiquement sur tous les plans : par l’écriture, la pensée, l’édition, les institutions, les rituels, les festivals, les plateformes numériques, les films, en somme avec ce qui fait notre environnement.
Je ressens de grands flux d’énergie, et je cherche à débusquer avec beaucoup où se tient le monument poétique de notre époque. J’ai tendance à le voir dans un mot: le «réseau»; et dans une formule qui le caractérise et l’infléchit: «le réseau Poésie».
L’esprit est aujourd’hui envisagé comme un réseau de neurones, un réseau de connexions, et je place mon écriture au milieu de tous ces flux, de tous ces nœuds, de tous ces scintillements, de cette constellation de poésie qui se tient en nous ou sur la planète, et qui répond aux constellations du ciel; comme un miroir. Ce miroir fonde le lieu où je me tiens.
«Ici et maintenant».
Vous sentez?
Nous sommes à Bellevaux, dans un cinéma. Nous percevons les vibrations de la ville, mais aussi celles des rivières qui traversent la ville, et surtout l’ampleur du lac, des montagnes, de cette région forgée par le glacier du Rhône. Elle a accueilli une grande quantité de poètes qui sont venus ici, et ont célébré les lieux. Je vois le tombeau de Rilke à l’Est à Rarogne, et celui de Borges à l’Ouest à Genève, comme ses deux seuils. Parce que nous vivons sur une terre de poésie.
En ces lieux, de nombreux actes sont menés, comme par le biais de cette fondation. Sans qu’ils le sachent forcément, je connais les membres de ce jury, parce que tous les jours, je regarde mon environnement, je l’explore; même si je les connais sans vraiment les connaître. Je lis Jean-Pierre Vallotton, Ferenc Rákóczy ou Jean-Dominique Humbert depuis mes vingt ans. Je vois le formidable travail de Catherine Seylaz-Dubuis sur les femmes artistes ou écrivaines en Suisse romande. Je parcours aussi l’écriture de Pierrette Micheloud, si attentive aux forces de vie, au moindre balbutiement d’une énergie provenant d’en-deçà des apparences. Je la remercie à travers ce jury, et je salue son nom comme celui d’une bienveillante protectrice.
Je regarde la salle, je regarde tous ces gens, nombreux, venus un lundi soir d’hiver, tous ces amis, toutes ces réponses, tous ces encouragements reçus ces derniers jours. Je suis extrêmement touché par cette présence, par ce rassemblement exceptionnel autour de la création vivante, de la critique active et bienveillante.
Plus largement, tous ceux qui font quelque chose avec le mot «poésie», qu’ils soient poètes ou non, m’intéressent. Ils forment ma «matrie» (puisque nous sommes ici sous le signe de Pierrette Micheloud). Tous font partie de la magnifique vallée poétique dans laquelle nous vivons.
L’épigraphe de ce recueil, écrite par Yeats en 1937, souligne les paradoxes d’être poète: «I am a crowd, I am a lonely man, I am nothing.» Une critique me disait récemment combien elle trouvait constamment des foules dans mon livre. L’observation est juste, mais un grand vide apparaît aussi, au centre, appelons-le «rien», ou, comme les mystiques espagnols le «Nada», ou comme les astronomes arabes le «Nadir», mais ce rien n’est pas un néant, un anéantissement, il est simplement l’envers, ce qui permet à l’ensemble de circuler, de se projeter, d’accélérer ou de ralentir, comme une grande turbine qui produirait de l’énergie, comme la grande roue d’un moulin, qui amènerait les vies à être broyées, tels des grains, pour donner leur meilleure huile. Ainsi, je vois le tableau de Bruegel (redéployé dans le film de Lech Majewski) nommé The Mill and the Cross, le Moulin et la Croix, ou encore Le Portement de la Croix.
Je rejoins Antonin Artaud lorsqu’il prétend que le véritable endroit est notre envers. Nous pouvons vivre à l’endroit dans nos fonctions, dans le fonctionnement de nos institutions, dans nos rôles mais, selon moi, le propre de la poésie consiste à être capable de tisser des liens entre l’envers et l’endroit. Nous pouvons y trouver le lieu, mystérieux de l’entre-deux. La poésie cherche à dire ce lieu, qui lie les morts et les vivants, le passé et le présent, le devenir à l’instant éternel.
J’ai la chance de pouvoir vivre en poésie du matin au soir; pourtant, même de cette manière-là, il reste toujours difficile de remercier correctement au moment de recevoir un honneur. Je conclurai ainsi. La trilogie prend véritablement naissance en 2007, dans le sud de la Pologne, dans un paysage qui m’a beaucoup marqué, la plaine de Birkenau, à côté de la petite ville nommée Oswięcim («Auschwitz» en allemand). À ce moment-là, sur cette plaine, j’ai su que j’allais écrire des poèmes mêlant un chant de noces et un chant des morts. Mais tout se révélait si subtil, si délicat, si périlleux, si intense, que je trouvais aussitôt gênant, peut-être indécent, de vouloir se poser en poète sur ce lieu, de vouloir écrire des choses sur l’énigme des destructions, des générations, des héritages et des fondations de l’Europe.
En 2017, dans le deuxième volume de la trilogie, intitulé Après l’Union, j’écrivais ceci:
«chaque écriture porte son éthique, sa probité, son exigence, et c’est au bout du silence que j’ai compris que je n’avais plus à être poète, et qu’ainsi je pourrais parvenir à la poésie.»
Je me redis cette phrase souvent. Je refais ce geste constamment. Non, je ne veux pas jouer au poète (même si je suis poète, et si je publie des livres de poèmes). Je ne tiens pas à prendre la pose, mais à déployer la force de la poésie. Je ne tiens pas non plus à écrire des poèmes, dans un genre spécifique, je cherche à capter le plus d’intensité possible, pour vivre pleinement, dans une conscience sensible, peut-être révélatrice, des puissances de la matière, avec empathie, et traverser l’existence sous cette forme, en poésie.
Antonio Rodriguez
2019
Thierry Raboud, pour Crever l’écran (Empreintes).
Parmi les ouvrages reçus pour notre Prix de Poésie 2019, à côté de livres de poètes connus, quatre recueils, de tonalités différentes, ont retenu notre attention, tous écrits par de jeunes poètes (j’entends par là, âgés de moins de quarante ans).
Chacun, à sa façon, révélait des qualités évidentes d’écriture. Pas de doute, la relève était assurée !
Mais pouvions-nous attribuer notre Prix à un premier recueil publié ?
Catherine Seylaz-Dubuis, Jean-Dominique Humbert, Ferenc Rákóczy et moi-même en avons débattu longuement.
Après tout, il suffisait (même si ce n’est pas une mince affaire) qu’il corresponde aux critères d’attribution de notre Prix et finisse par nous convaincre.
Crever l’écran, de Thierry Raboud, avait beaucoup d’atouts dans son jeu: une écriture personnelle et bien contemporaine; des textes brefs mais d’une grande densité, induisant plusieurs lectures possibles; une thématique intéressante qui interroge notre monde actuel en constante mutation, à l’aune d’un passé présumé connu et d’un futur qui ne laisse pas d’inquiéter.
Dans une société surconnectée, où geeks et internautes jouent des coudes à qui crèvera l’écran en premier, il est étonnant qu’un jeune homme d’un peu plus de trente ans choisisse la porte étroite du livre de poèmes imprimé pour nous transmettre son point de vue (qui est surtout celui de sa sensibilité artistique aiguë) et tenter aussi, mais au sens propre, de crever l’écran. Ah! ces écrans vers lesquels convergent tous nos regards avides d’images vides…
L’ouvrage primé s’articule nettement en deux parties, la seconde occupant le double de pages de la première (conférant ainsi davantage d’importance au présent), sobrement titrées avant et après, précédés du croisillon que les mélomanes nommeront dièse et les branchés, hashtag (que Thierry Raboud, en musicien averti, à l’affût de tous les sons, voudrait peut-être que nous décomposions en hache et tag, pour ouvrir ce mot, assez barbare pour notre oreille française, à d’autres significations).
Avant et après quoi? Vous l’aurez deviné: internet.
Ces deux parties sont enchaînées de façon très habile, par homophonie et paronomase: le dernier texte de la première partie n’est composé que de cinq syllabes: «L’autre / Mystère / S’y fier». Celui qui ouvre la deuxième reprend en son début, mais en un même vers: «l’autre mystère», suivi, au deuxième vers, de «si fier de n’être» (en écho donc à «s’y fier»), n’être qu’on peut aussi entendre naître.
Pourquoi d’un côté «L’autre / Mystère» et de l’autre «l’autre mystère»? Tout dépend de la façon de lire, que ce soit à haute voix ou dans sa tête.
Je suggère que le premier poème indique qu’autrui est un mystère, alors que le deuxième évoque un mystère différent, peut-être cette nouvelle ère de l’humanité qui a débuté avec l’apparition du tout-à-l’écran.
Je l’ai déjà signalé, le poème de Thierry Raboud nous en dit peu pour signifier beaucoup.
On remarquera également que tous les vers de la première partie, selon les canons anciens, débutent par une majuscule. Ce n’est plus le cas dans la deuxième, comme pour marquer une liberté prise par la modernité sur une tradition éculée.
Pour aller plus loin dans l’optique que j’ai esquissée précédemment, je serais tenté de discerner dans l’œuvre de Raboud une poésie du glissement, ou des glissements. Glissement de son en son pour mieux glisser de sens en sens, polysémie et polyphonie (renaissante, bien entendu).
Et n’y a-t-il pas là un certain cousinage avec le Leiris de Glossaire j’y serre mes gloses ?
Quelques exemples parmi d’autres dans Crever l’écran:
Page 19: «Blessure / Hâtée d’un dieu / Tombé trop vite / Sous le sens» — faut-il comprendre que ce dieu est tombé sous le sens, c’est-à-dire dieu révélé, ou au contraire qu’il a été déchu par notre modernité peu religieuse?
Juste après ces quatre vers, on trouve: «Remuer ciel» — et alors que l’on attend évidemment «Et terre», le poète déjoue notre attente en écrivant «Se taire»: on peut bien interroger le ciel, nulle réponse ne nous parviendra et nous n’aurons plus qu’à nous taire.
Page 45: «vague à larmes / et ce miroir» au lieu de vague à l’âme, ce qui se comprend aisément. Pour les trois derniers vers: «crever l’écran / beauté en touche / à tout reflet», on peut comprendre que la beauté a fait une touche, ou entendre «botter en touche», dans le sens figuré donné par Robert: «Se débarrasser d’un problème en éludant la difficulté». On peut difficilement s’empêcher de saisir également une allusion musicale aux touches du piano.
Quant au reflet final, il nous renvoie au miroir du 2e vers et «aux éclats» du 3e.
Réseau de mots en échos.
Page 56: Quand «la mémoire plante / ongles dans la falaise», c’est à l’emploi transitif direct du verbe planter (ou la mémoire est-elle une plante?). Mais c’est aussi, à l’emploi intransitif: la mémoire cesse de fonctionner (celle de l’homme ou de l’ordinateur?).
Page 25: En plus de l’homophonie dort/d’or, c’est un autre procédé qui est utilisé: dans une expression connue, un mot est remplacé par un antonyme pour en modifier la signification: «Ton silence dort /A poings ouverts» (renoncement à la lutte?). Ensuite, au lieu de coffres-forts (mot éminemment helvétique) on trouve «Les coffres faibles // De nos éveils [antonyme du silence du 1er vers] / Ensevelis».
Quant au rhizome de la page 43, veut-il nous renvoyer à Deleuze et Guattari? Leur idée que tout élément peut influencer un élément de sa structure et réciproquement, ne s’applique-t-elle pas parfaitement au livre de Raboud?
Celui-ci ne manque pas non plus d’évoquer Rimbaud, page 61: «elle est retrouvée / l’éternité —» et page 40, le Je est un autre rimbaldien devient «je me / ressemble» (je ressemble à moi-même ou Je ressemble à moi?).
Page 55, en lisant le dernier vers: «souffle cou-» (dans la 2e partie, certains mots ou phrases sont tronqués), on ne peut s’empêcher de penser au Soleil cou coupé d’Apollinaire.
Crever l’écran — un livre qu’on n’a pas fini de relire et d’interroger.
Jean-Pierre Vallotton, président du Jury
Chers amis,
Il n’y a pas de poésie sans feu, et je dois au jury qui m’honore ce soir d’avoir attisé une flamme qui tout juste vient de naître sur un lit de bois vert. Déjà vous lui offrez un rayonnement digne des plus anciens brasiers, des plus ardents forgerons-poètes et autres souffleurs de vers.
Pourtant, à l’heure de vous remercier avec toute l’émotion du jeune premier, je ne m’excuserai point d’avoir encore si peu vécu, si peu écrit, si peu publié, si peu versifié. Car il n’y a pas d’âge pour être jeune, pour être vieux. Ni pour se savoir poète ; une désespérance et une étincelle suffisent, voici que s’enflamme le langage que nous habitons comme une demeure de bois sec, incendie courant des fondations jusqu’aux combles et qui ne laisse après lui qu’une structure calcifiée, noircie, élémentaire. Ce qui reste alors, après l’incendie, c’est le poème. Non, il n’y a pas d’âge pour bouter le feu à la vieille cathédrale de notre verbe, et regarder un ciel neuf s’ouvrir au-dessus de nos têtes.
Le poème comme calcination, là où Pierrette Micheloud évoque pour sa part une décantation quasi viticole. Voici qui ouvrirait idéalement les feux, si je puis dire, d’une érudite logorrhée sérieuse dans laquelle le poète honoré, farcissant son propos de citations qui en jettent, déploierait une sorte de manifeste esthétique destiné à rassurer les membres du jury quant à la pertinence de leur choix.
Vous m’excuserez, je n’en ai ni le goût, ni la plume. Le poème n’est pas un art sérieux, c’est un art vivant, or la vie elle-même n’est pas sérieuse. Sait-on d’ailleurs seulement pourquoi l’on vit, alors allez savoir pourquoi on écrit, qu’est-ce qui brûle en nous pour que nous cherchions sans répit les mots capables de répondre aux questions informulables qui nous assaillent.
Je n’en sais rien, ou si peu. Mais certes depuis longtemps déjà : les poèmes de Crever l’écran sont nés avec le millénaire puis ont longuement été réduis jusqu’à leur plus simple expression. Ils sont pour moi la charpente intime de ce siècle veiné d’algorithmes, l’« essentielle ossature » de notre temps, sur laquelle il nous faut bâtir de nouvelles manières d’être au monde, de nouvelles consciences du soi et du nous. C’est donc une poésie arrimée aux incertitudes de notre modernité que vous honorez ce soir, et je vous sais infiniment gré de cette audace, de ce courage. Oui, la poésie a besoin de nouvelles voix pour dire ce nouveau monde, et je vous sais gré d’avoir couronné la mienne de vos faveurs.
Mais à travers vous, chers membres du Jury du Prix Pierrette Micheloud, c’est surtout une inconnue qu’il me faut saluer, à qui je dédie ce petit récit intitulé Vendanges et os à moelle, dont vous excuserez, je l’espère, la légèreté qui sied à mon humeur du soir.
Vendanges et os à moelle
Ou comment j’ai rencontré Pierrette Micheloud
C’est un nom charnel et ancien, qui sent la pierre et le pain. Mais sinon il ne m’évoquait rien, ce nom, Pierrette Micheloud. Et soudain voilà que vos pairs vous repèrent, vous écrivent, vous appellent, vous priment, vous hissent bien malgré vous au sommet du Parnasse d’où ils croient apercevoir les sentiers glorieux de la destinée littéraire qui sera la vôtre, vous y poussent en une ferme et chaleureuse ruade, vous lançant sur cette voie poétique que vous n’avez pour l’instant foulé que d’un timide orteil, vous flanquant pour tout bagage la mémoire d’un nom dont ils aimeraient, à travers le cheminement de vos vers, saluer la mémoire : Pierrette Micheloud.
C’était un samedi tout enluminé d’automne, ruisselant de sueur dorée. Sur mon écran ces mots pressants : « auriez-vous l’obligeance de m’appeler rapidement ». J’obtempère, puis la voix de Jean-Pierre Vallotton, qui y va par quatre chemins pendant que je frétille comme un point de suspension. Enfin, l’impensable annonce, accolée à ce nom d’une désuète sensualité.
Je boucle, je chancelle vers ma femme et ma fille qui jouent au train Duplo, je les embrasse humidement, je donne son congé au valeureux chauffeur de locomotive, puis nous fonçons vers le soleil pour garder la nouvelle au chaud, profiter des pentes de Lavaux pour se remettre la tête à l’endroit, d’un verre de blanc pour la remettre à l’envers. Nous suivons jusqu’à Grandvaux les nuées déçues des étourneaux car les vendanges viennent de se terminer. Je pense à ce nom tandis que les rues flottent dans une odeur sucrée de pulpe chaude. Les cuves et les caves débordent de grains en folie. Le bourg est traversé de processions ramuziennes de cueilleurs ivres, juchés sur des camionnettes enrubannées. Leur joie est la nôtre, nous dégustons, puis rentrons quelque peu grisés, sans savoir encore que c’est à quelques centaines de mètres de la dernière demeure de Pierrette Micheloud que nous avons trinqué à sa mémoire.
De retour à l’horizontale de mon bureau, j’ai fouillé dans les entrailles du rayon poésie de l’étagère qui menace toujours de s’effondrer sur mes velléités littéraires: elle était là, discrète, serrée entre Pierre-Louis Matthey et Anne Perrier. Son nom minuscule sur dos très fin de l’opuscule bleu nuit dont j’avais oublié l’existence : Pierrette Micheloud (1).
Mais il me fallait la rencontrer plus avant que dans ces vers aux beautés de marbre testamentaire. En ville, j’ai continué ma quête. A la bibliothèque, j’ai déniché son recueil saphique intitulé Elle, vêtue de rien (2), livre violet jauni, gondolé, comme sauvegardé d’on ne sait quelle montée d’eau. Puis à la librairie, j’ai mis la main sur le Choix de poèmes (3) établi par Jean-Pierre Vallotton et qui sent encore le neuf. Enfin, à la boucherie, j’ai acheté de quoi faire un bœuf bourguignon, ragoût qui n’aurait pas mérité son nom sans les trois petits os à moelle que le boucher, au moment de me laisser repartir, m’a hâtivement emballés puis offerts, et que j’ai par erreur lancés dans mon sac à poèmes où je les ai oubliés quelques jours. Trois Pierrette Micheloud, trois os à moelle. Evidemment les uns suintèrent quelque peu sur les autres, d’où il résulta que tout se mit à sentir le verbe et le gras.
Ceci pour dire que ce nom de pierre et de pain qui ne me disait rien, sera pour moi désormais incarnation de chair et de vin. Toujours il me chantera le poème comme ivresse et satiété. Toujours il me rappellera que le poème est une vendange tardive, une communion. Voilà comment j’ai rencontré Pierrette Micheloud.
A bien y réfléchir, l’association vineuse et moelleuse est plus substantifique qu’il n’y paraît. Car en ouvrant ses livres, l’arôme persiste au fil des images.
Entendons-là, dans ses Derniers poèmes chanter « la moelle épinière des mots », puis admirons avec la « veilleuse des vignes vermeilles » les coteaux de son Valais natal qu’elle suggère dans Elle, vêtue de rien :
Dans les vignes que tu cultives
A l’orée
De la menthe sauvage
Il n’est pas deux grappes
De même saveur.
L’existence comme un cep tourmenté, un os à trancher. Le poème comme fruit, comme moelle. Voilà où j’en étais arrivé en suivant ce bouquet d’odeurs, mais qui ne faisait pas encore d’elle une sœur. Il me fallait entamer le dialogue, et pour cela plonger plus avant dans ses vers. C’est dans ce poème offert A la poésie, que j’ai trouvé sa désespérance et son étincelle.
Marcher sur tes pas
Foudroyer les masques
Apprendre à sonder
L’abstraction
La faire chanter
Avec les mots de ton choix
Onction d’étoiles
Dans les éboulis (4)
Ici la langue vibre dans le palais du poème, avec une simplicité puissante à laquelle j’aspire, que désormais j’admire. Mais c’est avec un poème intitulé Bientôt votre tour, solitaires de la vie (5), à la fois ésotérique et technocritique, que j’ai découvert en Pierrette Micheloud une sœur d’inquiétude. Poème plein de courts-circuits écrit en 1979, et qui fait étrangement écho à Crever l’écran.
Des vers qui désormais chemineront à mes côtés, sur cette voie d’écriture que tant d’autres ont accompagnée, et qu’il me faut enfin remercier ici. A José-Flore Tappy et à feu Philippe Rahmy, qui ont su trouver les bons mots au bon moment, je dois ma persévérance. A mes éditeurs, qui défendent la poésie d’aujourd’hui avec une ténacité rare, je dois ce livre.
Enfin, je dois tout à ma grand-mère qui m’a fait aimer l’odeur du verbe, à mes proches qui toujours ont nourri ce que je suis, à ma fille qui pétille, surtout à ma femme Mary-Laure qui heureusement aime le bœuf bourguignon et sans qui je serais resté sur le rebord de la vie.
Je vous remercie de votre attention.
Thierry Raboud, 2 mars 2020
(1) Derniers poèmes (2003-2006), Ed. Le Miel de l’Ours, 2015.
(2) Elle, vêtue de rien, Ed. L’Harmattan, 1990.
(3) Choix de poèmes (1952-2004), Ed. L’Age d’Homme, Poche Suisse, 2011.
(4) Derniers poèmes, p. 38.
(5) Choix de poèmes, p. 101.
2018
Richard Rognet, pour Les frôlements infinis du monde (Gallimard).
Bonsoir, S’il est des poétiques fondées sur le refus, la rupture, la négation, celle de Richard Rognet, lauréat de notre Prix 2018 pour son livre «Les frôlements infinis du monde», en est bien éloignée.
En effet, tout, dans sa poésie, cherche à tisser des liens, avec le passé, le présent et le futur; avec tout ce qui l’entoure; avec les autres et soi-même.
Dans la poésie française actuelle, je vois peu d’œuvres qui dégagent une telle présence au monde (et c’est sans doute ce que veut nous dire aussi le titre de ce nouveau livre).
A ce propos, j’ouvre une parenthèse: vous serez peut-être intéressés de savoir que Richard Rognet emprunte en général le titre de chacun de ses livres à un poème de l’ouvrage qui l’a précédé. C’est ainsi que l’on peut lire dans «Dans les méandres des saisons», de 2014, à la fin d’un texte consacré aux oiseaux, que ceux-ci chassent «les encombrantes / tristesses, les regrets qui s’infiltrent / partout, les idées noires et la crainte / de ne pas pouvoir reconnaître, parmi mes / phrases, les frôlements infinis du monde.»
Poésie de la célébration, donc. Mais loin des grandes orgues de Claudel ou Saint-John Perse, c’est plutôt le chant d’un hautbois que l’on croit percevoir.
La nature célébrée est celle qui depuis toujours constitue le paysage de Richard Rognet, cette région des Vosges où il est né et qu’il n’a guère quittée, à ce qu’il semble.
Ce livre palpite de vie: ce sont les sources, les montagnes, les forêts. Le vent y répond à la neige, les étoiles aux étangs, les nuages aux champs.
Comme avant lui Messiaen ou le Poverello d’Assise, notre poète a la passion des oiseaux, qui semblent s’envoler d’un livre à un autre.
Parfois, leur présence est seulement signalée par une notation un peu vague, tel cet arbre qui «se réjouit du passage / des oiseaux dans ses branches» ou «la rosée matinale / où s’abreuve un oiseau»; ailleurs, ce sont «les restes lumineux d’un ramage / d’oiseaux».
Mais pour bien connaître, il faut savoir nommer, avec précision. Qui prétendrait ne pas connaître le nom de ses amis?
C’est ainsi qu’apparaissent la mésange et le pinson, l’hirondelle et le merle, le corbeau et le rouge-gorge.
D’autres animaux aussi font partie du décor: la vache et le chat, la taupe (désignée uniquement par son habitat), les abeilles, papillons et autres insectes.
Comment ne pas penser à Pierrette Micheloud et ses «Seize fleurs sauvages à dire leur âme» quand tant d’entre elles jalonnent ces pages? Elles se nomment rose ou géranium; lilas, pervenche, bruyère, épilobe; gentiane, jonquille, crocus, pissenlit; coquelicot, pâquerette, iris et même, pourquoi pas?, orchidée.
Les arbres ont nom pin, hêtre, tilleul, bouleau, sapin. Ce sont comme des frères. Le poète n’écrivait-il pas dans «Dans les méandres des saisons»: «mieux vaut / étreindre un arbre, n’écouter que lui — se taire»?
Toutes ces manifestations, parfois infimes, du monde auquel nous appartenons sont peut-être notre bien le plus essentiel: «revenons / au chat, aux feuilles, ils sont d’ici, / ne soyons pas plus qu’eux, disons-nous / que le peu qu’ils proposent / est le sommet précieux de notre destinée.»
Vœu de pauvreté, d’humilité — voilà qui nous ramène encore à saint François.
Le poète peut se sentir si proche de la nature qu’il va jusqu’à écrire dans «Elégies pour le temps de vivre»: tu prends / les sources contre toi, tu les fais / courir sous ta peau, dans ta chair, / comme autant de nouveaux vaisseaux».
Fort est son besoin d’enracinement, dans une terre, dans une histoire familiale, ancestrale, dans l’univers. Il l’exprime souvent, ainsi dans ce dernier livre: «tu sais / qu’en toi les saisons s’enracinent». Plus loin c’est «une exubérance / de parfums, de reflets, de couleurs, / où semblait prendre racine / l’immensité du monde.»
Ce monde, il le sait aussi en péril, comme le remarque judicieusement Béatrice Marchal, qui nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir, en pressentant un «sentiment de catastrophe générale.»
Tout n’est évidemment pas rose dans la vie du poète. Il confesse même: «je suis obscur, je m’en excuse». Ailleurs il évoque «une ancienne blessure». Il parle de lui en ces termes: «moi qui ne saurai jamais / comment vivre s’écrit».
Dans l’un des derniers poèmes du livre, on pourrait voir comme un possible constat d’échec et le texte se termine par cette interrogation lancinante: «Qu’aurait-il donc fallu?»
C’est notamment grâce à notre jury, qui se compose, je vous le rappelle, outre moi-même, de Mme Catherine Seylaz-Dubuis et MM Jean-Dominique Humbert et Ferenc Rákóczy, que j’ai le plaisir d’accueillir ce soir Richard Rognet.
Jean-Pierre Vallotton, président du jury
2016
Nimrod, pour Sur les berges du Chari, district nord de la beauté (Ed. Bruno Doucey).
Remise du Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2016 à Nimrod au café-théâtre Le Bourg, à Lausanne, le 31 octobre 2016.
C’est ainsi que notre jury, composé , je vous le rappelle, de Catherine Seylaz Dubuis, Jean-Dominique Humbert, Ferenc Rakoczy et moi-même, a décidé d’attribuer le prix de Poésie Pierrette Micheloud 2016 à son dernier recueil «Sur les berges du Chari, district nord de la beauté».
L’une des richesses de ce livre est sa diversité et son souci de renouvellement par rapport aux recueils qui l’ont précédé. En effet, Nimrod ne fait pas partie de ces poètes dont on a l’impression qu’ils passent leur vie à réécrire le même poème figé dans une forme immuable. Je pense que Nimrod respecte trop ses lecteurs pour ne pas avoir envie de les surprendre, voire de les dérouter – pour leur plus grand plaisir. Le livre que nous honorons ce soir est articulé en cinq parties bien distinctes, qui révèlent cette diversité que j’évoquais à l’instant.
On y trouve notamment des poèmes très courts, presque aphoristiques, dont l’effet de concentration poétique est d’autant plus efficace.
Permettez-moi d’en citer quelques-uns :
« Dans le chambranle de la lumière, je ravauderai la porte » (sans doute pourrait-on évoquer ici l’ombre tutélaire de René Char).
« Tu n’attends pas l’été / chose ultime // tu flambes / tu n’es jamais chez toi / oublié / dans le soleil ».
Ou encore : « C’est ma mère / qui attend / son dos tourné / vers moi / telle une stèle ».
D’autres poèmes, au contraire, son animés d’un souffle puissant, qui nous entraîne dans son sillage sur plusieurs pages, rythmés avec art.
Voici le début de « Tam-tam » :
« Revoir les dieux / les jeunes dieux / les déesses // faut y croire / croire au tam-tam / tam-tam au cœur / chamanique / totémique // cris proférés / cris différés // tam-tam totémique / tam-tam chamanique // pour le dieu pour le miracle // toujours montera le cri / qui renverse le monde / dansant chantant »
Nimrod n’est pas seulement un poète de la nostalgie, de la célébration de la vie et d’un lyrisme de haut niveau. Il est également un homme témoin de son temps et des atrocités qui le gangrènent et font honte à l’humanité. Le poète éprouve alors la nécessité impérieuse de clamer sa colère, donner libre cours à son indignation (ce n’est donc par hasard que cette partie du livre s’intitule « L’enragement ». C’est ainsi qu’il rend hommage aux mineurs grévistes fusillés en Afrique du sud en 2012:
« ils ont remis ça / ils tirent cette fois avec des balles blanches et noires / le sang est désespérément rouge / comme au premier lever de soleil sur le monde / comme du temps de Caïn »
ou aux étudiants tchadiens brutalement réprimés en 2015 :
« Ils les frappent avec des tuyaux d’arrosage / Ils les frappent avec des tuyaux en latex // Ils les frappent sous le soleil de midi / Ils les frappent en double salto // La poussière meuble camaïeu / La poussière douceur oubliée // La poussière crève la dalle sans dalle / Sous le brodequin des ninjas souriants »
Poète de la tendresse, poète de la révolte, c’est une des très grandes voix de la poésie française d’aujourd’hui que j’ai le très vif plaisir d’accueillir parmi nous ce soir.
Jean-Pierre Vallotton
Mon cher Jean-Pierre Vallotton,
Par quel chemin la vie nous mène quelquefois!
Le prix par lequel tu m’honores, de conserve avec les membres de ton jury, j’étais loin d’en rêver ! Cela fait quelques années que nous sommes sans nouvelles l’un de l’autre. Et pourtant, je garde intacte la mémoire de nos promenades parisiennes, le soir, au début des années 2000. Mes oreilles bourdonnent encore de nos conversations…
L’émotion me submerge lorsque je songe à Cora Vaucaire, à Patachou et tant de voix à textes, pour ainsi dire, des voix gorgées d’humanité et à travers lesquelles la vie étreint à chaque inflexion de syllabe – de même que chaque timbre, chaque couleur musicale. Tu as fait mon initiation, je l’avoue. Je n’insiste pas en ce chapitre parce que le Nobel de littérature vient d’échoir à Bob Dylan…
Car Pierrette Micheloud ne cherchait pas – en tout cas, pas en ma présence – à chanter.
On s’était vus à trois, je ne me rappelle ni la circonstance ni le lieu. C’était probablement à Paris. Elle m’avait offert – ou me l’avait-elle fait envoyer de Suisse? – un assez gros volume de son anthologie personnelle. Pendant notre rencontre, je me souviens qu’elle me regardait de biais. Avec le recul, ce regard a acquis un sens qui m’avait échappé à l’époque.
C’est Choix de poèmes (1952-2004), l’anthologie établie par tes soins, qui m’a permis de voir Pierrette Micheloud – de la voir et de l’entendre, tout ensemble.
Alors, je me suis souvenu qu’elle me regardait de biais comme m’ajuster à sa propre scansion. Sans doute, j’arrange un portrait trop flatteur pour moi. Il n’empêche. Quel poète, quel écrivain n’a jamais cherché chez un confrère, une consœur l’image éperdue de lui-même ? C’est une réaction des plus banales — un acte réflexe, en somme. Dans le meilleur des cas, ils constituent la première marche qui nous déprend de nous-mêmes.
Quand on s’est vus, Pierrette Micheloud, par sa posture, se demandait si je pouvais l’entendre. Aussi m’offrit-elle son profil. Comme je la remercie pour sa subtilité!
Mes poèmes, en effet, sont à l’opposé du lyrisme où baignent les siens. Flaubert avait réputé impossible tout dialogue entre les styles, mais est-ce si sûr? Car, hormis l’enfermement dans une unique esthétique, aucun obstacle n’est irréductible. Tous les styles communiquent, telle est la banalité qui échappe si souvent aux écrivains! Comme je suis heureux de retrouver intacte la figure de Pierrette Micheloud dans «Intermède», par exemple :
Et commença la captive errance
De l’œuvre au noir
Le joug de l’instinct possessif
La dure servitude.
Reviendra-t-elle
La saison blanche
Neige
Aux vastes draps des amantes
Leur nuit, leur étreinte
Leurs rêves de poissons rouges?
Une solitude s’énonce, une parole aux antipodes de la parole, tant elle fraye avec les hauteurs. La vision devient son, le son devient espace, l’espace s’abîme dans le vide, un vide habité, mais solitairement – «les poissons rouges» le colorent à peine. Face à ce poème, son auteure se demandera toujours avec raison ce qu’un lyrique de mon espèce peut bien y comprendre. A priori, elle n’aura pas tort!
Néanmoins, nous partagions beaucoup de choses, car j’ai pratiqué plusieurs veines en poésie… Entre autres, son poème intitulé «Partage» pourrait nous réconcilier:
Terre et flamme
Toujours ce duel
Au centre du mot
Tour à tour
Espoir et torture.
Nous savons ces choses
Comme un lys
À l’heure d’éclore
Sait l’aveu
Qui brûle et se tord
Dans l’orgie
Complexe du blanc.
Il y a un élément qui parcourt la poésie de Pierrette Micheloud, et que je cultive, tel un forcené, comme elle: le registre du mineur. Même en Occident, peu de poètes sont sensibles à ce registre-là.
Chez nombre de nos confrères, la poésie, tel le chant a capella, est accordée au mode majeur. Les infimes nuances où les voyelles accueillent le vide dans le registre mineur sont gommées. Pierrette Micheloud manie cet art à merveille. Sa parole se suspend sans cesse, avec un soupçon de métaphysique qu’elle évacue avec son aptitude sans pareille à coller au concret.
Là où le solaire l’emporte chez moi jusqu’au lyrisme le plus échevelé, le mineur lui permet de circonscrire sans tapage, sans violence, juste avec cette clarté qui repose le cœur, les yeux, les choses. Ce n’est rien et c’est tout.
La hauteur qui caractérise sa voix a quelque chose de Marguerite Yourcenar. Mais elle s’ingénie à la masquer, à la faire oublier. Car son poème est discours, un discours qui produit un éclat sombre – sinon translucide, telle la chrysalide à laquelle elle fait allusion si souvent.
Pierrette Micheloud est une voix, unique par définition, une veilleuse éveillée.
Réponds, ô frère
Absent par les autres,
Toi,
Le seul d’être assez seul
Pour capter la souffrance
De cette étoile qui marche
En marge des constellations1.
Pierrette Micheloud raconte son histoire, celle des femmes, des choses et du monde avec une évidence arrachée au tumulte de la vie. C’est beau comme l’éclat du «Deuxième jour»:
Plus loin ces gardiennes
Autrefois des cimes, ronde
Blanche autour de toi:
«Pour nous… – leur voix toutes ensemble –
La pureté va de soi»
L’écriture est une conquête.
Nimrod
Amiens, Plachy-Buyon, 19 octobre 2016.
1 Pierrette Micheloud, «Vingtième siècle», Choix de poèmes (1952-2004). Établie et présenté par Jean-Pierre Vallotton, L’Âge d’Homme, Lausanne, 2011, p. 100.
2015
Werner Lambersy, pour Dernières nouvelles d’Ulysse (Editions Rougier V.).
Remise du Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2015 à Werner Lambersy au café-théâtre Le Bourg, à Lausanne, le 16 novembre 2015.
Dans l’intervalle, notre poète s’est rendu notamment à Bruxelles où il a eu le plaisir d’entendre une œuvre dont il a écrit le texte, «Déluges et autres péripéties», sur une musique de Annettte Vande Gorne.
On le voit, Werner Lambersy n’a pas pour habitude de se tourner les pouces, ou alors, c’est pour en faire jaillir les étincelles d’un nouveau poème, comme notre ancêtre commun frottait silex contre pyrite pour illuminer sa caverne, sur laquelle Platon n’avait pas encore projeté son théâtre d’ombres douteuses.
Pour preuve: son impressionnante bibliographie, avec entre autres de très nombreux livres d’artistes, et les multiples prix qui ont couronné ses ouvrages.
Le sentiment d’universalité qui se fait jour dans «Dernières nouvelles d’Ulysse» trouve sa source non seulement dans la vaste culture du poète, mais aussi dans son parcours personnel: né à Anvers en 1941, dans un milieu de culture flamande, il sera très tôt confronté à l’image dérangeante du père. D’abord par son absence (il s’est engagé dans le conflit mondial), ensuite par les convictions qui l’ont poussé à le faire: persuadé que l’utopie sociale du communisme est un danger majeur pour l’humanité, il a épousé la cause de l’extrême-droite et s’est enrôlé dans la Waffen-SS.
Jusqu’au décès de son père, en novembre 2001, le poète multipliera les tentatives de rapprochement avec cet homme dont les motivations profondes lui échappent. Il ira jusqu’à lui envoyer ses livres de poèmes, auxquels il avouera ne rien comprendre.
Car depuis 1955, il écrit des poèmes. S’il ne fait pas sienne l’idée d’Adorno qu’«écrire un poème après Auschwitz est barbare», il décide toutefois de renier la langue de son père (et surtout les idées fachistes qu’elle a véhiculées) et choisit donc de s’exprimer en français, un choix qui sera définitif.
Le monde, il le découvrira à travers les nombreux voyages professionnels qu’il effectuera au fil des ans: Etats-Unis, Indes, Philippines, Chine, URSS par le transibérien, etc.
Ce qui a décidé notre Jury, composé de Catherine Dubuis, Jean-Dominiqe Humbert, Ferenc Rákóczy et moi-même, Jean-Pierre Vallotton, à attribuer notre Prix de Poésie 2015 à «Dernières nouvelles d’Ulysse», c’est que ce livre, composé sur une dizaine d’années, est peut-être bien le plus accompli de son auteur. Sur une centaine de pages, emboîtant le pas à celui d’Ulysse, le lecteur est baladé aux quatre coins du monde, pour revivre quelques-uns des événements majeurs, et souvent destructeurs, qui ont ébranlé la planète au cours du siècle passé: guerres, dictatures, cataclysmes et désastres, échecs écologiques, j’en passe et des meilleures.
Nulle chronologie apparente à cette nouvelle odyssée, qui se présente plutôt comme un patchwork, un tourbillon vertigineux qui tisse en son cocon des liens étroits avec le passé.
Le livre s’ouvre par ces mots: «Ici commence / Le chant qui jamais / N’a cessé». Car c’est le plus souvent par la voie du lyrisme (parfois teinté de sarcasme, il est vrai) que Werner Lambersy nous donne à entendre ses mots.
«Quelque chose qui ferait / Qu’on entend / Un caillou en le touchant // Et qu’il chante au dedans / Autant que le vent / Au-dehors // Qu’on sache qu’un poème / Se tient là pour le dire».
Si le livre est également émaillé de nombreuses citations d’artistes et penseurs de tous horizons, la richesse des images propres à Lambersy reste remarquable: «Nous tournons / Dans la porte à tambour / Du grand hôtel de l’espace // La mort au gilet rayé / De crépuscule nous balaiera // Comme le plumet éparpillé / Des pissenlits fanés / Du souffle».
Pour essayer d’en apprendre un peu plus sur ce livre fascinant, je prie Werner Lambersy de venir me rejoindre.
Jean-Pierre Vallotton, président du jury
2013
Charles Dobzynski, pour Journal de la lumière & Journal de l’ombre (Le Castor Astral).
Soirée de remise du Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2013 à Charles Dobzynski au Café-théâtre Le Bourg, à Lausanne, le 8 octobre 2013.
Ce n’est pourtant pas un poème autobiographique qu’a écrit Charles Dobzynski, mais plutôt ce que je serais tenté d’appeler une suite polyphonique en universel majeur, si une telle tonalité peut être perceptible à l’oreille humaine.
En effet: de quoi est-il question dans ce livre? A peu près de tout, tout ce qui fait la grandeur et la décadence de l’homme, du monde dans lequel il vit, plus ou moins harmonieusement selon les guerres et les saisons.
A partir d’un thème, l’ombre et la lumière, que l’on pourrait croire épuisé depuis longtemps, Charles Dobzynski, en grand maestro, a su orchestrer des variations surprenantes, souvent induites par des expressions bien connues telles que «n’être que l’ombre de soi-même», «que toute la lumière soit faite», «un caractère ombrageux» ou encore «une ombre au tableau».
Il y est beaucoup question du cosmos, de la naissance de l’univers et du ballet des planètes (ce qui avait déjà inspiré à l’auteur, en 1963, un ensemble de poèmes tout à fait unique, à ma connaissance, dans l’histoire de la poésie, intitulé «L’opéra de l’espace»).
Question aussi des bien-nommés Auguste et Louis Lumière, les inventeurs de ce qui n’allait pas tarder à devenir le 7e Art, que Charles Dobzynski ne cessera de scruter tout au long de sa carrière de critique cinématographique. C’est ce qu’il appelle «la boîte de Pandore d’où s’échappèrent illico non pas tous les vents mauvais et toutes les misères du monde mais toutes les ombres et tous les fantasmes de l’inconscient».
L’univers des peintres y est aussi présent, de Botticelli à Soulages, en passant par Bosch et Monet.
On y fait également un petit détour du côté de la dynastie des Ming, pour évoquer, évidemment… les ombres chinoises.
Dans le Musée des Ombres, on pourra croiser les figures imposantes de de Gaulle, Mao, Einstein et Picasso.
Ceci pour donner un aperçu de la diversité des thèmes qui irriguent ces poèmes.
Si l’on y voyage beaucoup à travers le temps et l’espace, l’époque contemporaine est loin d’être ignorée — et c’est une constante de l’écriture de Charles Dobzynski que d’être à l’écoute de son temps, pour s’en faire le témoin, le lyrisme n’éludant pas la lucidité.
C’est souvent par un glissement sémantique ou un calembour que le poète nous fait passer d’une fredaine à un sujet sérieux, voire dramatique, ce qui explique la diversité des tonalités dans lesquelles ce livre est composé.
Par exemple: «Plus tard, une ère sinistre a voulu que les ombres ne soient plus portées mais déportées, non plus simples silhouettes, mais présences trouées d’étoiles jaunes, pour finir leur itinéraire en tas de cendres».
Ailleurs, un texte intitulé «Le pôle emploi de la lumière» est une longue métaphore filée qui permet d’évoquer le chômage qui gangrène notre société et suscite toutes sortes de discriminations.
A d’autres occasions, c’est un ton bien différent qu’adopte l’auteur: celui de la colère et de la révolte face aux injustices qui sont faites à l’homme:
«Que toute la lumière soit faite!
Tant d’intelligence censurée! Tant de vérité pressurée! Tant de justice déjugée, adjugée aux enchères! Tant de peines de cœur commuées en peines à perpétuité! Tant de beauté battue comme fille publique! Tant de justes causes bafouées! Tant de certitudes dévoyées! Tant de sagesse inemployée! Tant d’existences mutilées! Tant d’horreur non élucidée!
Que toute la lumière soit faite!»
On voit par là que rien de ce qui est inhumain ne saurait être étranger au poète.
Pour terminer, je voudrais dire quelques mots de l’architecture de cet ouvrage, qui sort également de l’ordinaire.
Chacune des deux parties du livre, déterminées par son titre, se divise en 13 ou 15 «chapitres», composés eux-mêmes d’une suite de tercets qui sont autant de savoureux aphorismes, puis d’un texte en prose poétique, que complète parfois une petite comptine ou une fable.
Je ne puis résister au plaisir de vous citer quelques-uns de ces aphorismes en avant-goût de la lecture complète de cet ouvrage que vous ne manquerez pas de faire, j’en suis certain — si ce n’est déjà chose faite.
«Le seul fossoyeur que connaisse / La lumière / C’est le trou noir»
«Les papillons sont les copeaux / De la lumière / Ebéniste de table rase»
«On croit la lumière orpheline / C’est que sa mère / L’a déclarée sous rayon X»
«Regarde dit l’ombre : je me déploie / Comme un parapluie / Pour te protéger de toi-même»
«Un peuple entier d’ombres / Peut se soulever / Pour revendiquer la lumière».
C’est pour toutes ces raisons que notre Jury, composé, je vous le rappelle, de Mme Catherine Seylaz-Dubuis, MM. Julien Dunilac, Jean-Dominique Humbert et moi-même, n’a guère eu de peine à se mettre d’accord sur l’attribution de notre Prix de Poésie 2013.
Evidemment, nous savions depuis longtemps que Charles Dobzynski est un poète remarquable dont l’originalité et la profondeur n’ont fait que s’affirmer au cours des ans, et c’est une œuvre considérable qu’il nous a déjà offerte — œuvre de poète avant tout, mais aussi de romancier, nouvelliste, traducteur, auteur pour enfants, essayiste, critique de cinéma.
Nous allons à présent en évoquer différents aspects et pour cela j’ai le grand plaisir de demander à Charles Dobzynski de bien vouloir venir me rejoindre.
Jean-Pierre Vallotton, président du jury
2012
Vénus Khoury-Ghata, pour Où vont les arbres? (Mercure de France).
Soirée de remise du Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2012 à Vénus Khoury-Ghata le 23 octobre 2012 au Café-théâtre Le Bourg, à Lausanne.
Derrière son évidente fantaisie, cette formule est peut-être plus profonde qu’il n’y paraît; et je serais même tenté de l’appliquer à l’œuvre de Vénus Khoury-Ghata, lauréate, vous le savez, de notre Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2012.
Allons y voir de plus près, si vous le voulez bien.
Tout d’abord, cette expression: document imaginaire, dont les deux termes pourraient sembler antithétiques.
Rappelons la principale définition que donne Robert du mot document: «Ecrit, servant de preuve ou de renseignement». Dès lors, comment une preuve pourrait-elle être imaginaire?
Et pourtant, il me semble évident que la poésie de Vénus Khoury-Ghata accomplit aussi bien l’une et l’autre proposition. Car elle est à la fois ce document qui rend compte du réel, de l’immanent, de la vraie vie vécue, avec sa part indéniable de souffrance et de cruauté — souvenirs d’enfance douloureux, images obsessionnelles de la guerre et de la mort (et l’actualité récente, hélas!, est là pour nous le rappeler) —, et cette fenêtre ouverte sur l’imaginaire, avec sa richesse métaphorique qui insuffle un peu d’espoir malgré tout, à travers un sentiment d’unité universelle et de fraternité entre tous les règnes, animal, végétal et minéral. Grâce aussi à une pincée d’humour non négligeable.
Tout ceci nous ramène parfaitement à la deuxième partie de la définition tentée par Carl Sandburg: «… comment on fait des arcs-en-ciel et pourquoi ils disparaissent.»
Les arcs-en-ciel sont nombreux dans la poésie de Vénus Khoury-Ghata. Ce sont ces images chatoyantes et originales que j’évoquais à l’instant.
En voici un petit florilège:
«Ils disent les glaciers sans cœur alors qu’ils fondent à la seule vue / d’une pâquerette»
«il ramassait les tessons des lunes / de peur qu’ils ne blessent les pieds des dormeurs»
«un enfant s’enveloppe d’un grand rire de voyage / et s’en va / après avoir fermé la terre à clef»
«Les livres que nous feuilletions venaient de la forêt qui nous regardait lire / du cri de l’écorce qui se prolongeait sous la peau des pages»
«La cheminée toussait si fort / qu’on lui interdit de fumer plus d’une bûche par jour»
«Un brouillard sonne à la porte / le chat qui garde le feu / lui conseille de ne pas s’effilocher / sur le paillasson»
Si Mille et Une Nuits et surréalisme ont sans doute ajouté une touche de couleur insolente à ces arcs-en-ciel-là, il est d’autres images qui dans leur fulgurance me paraissent d’une justesse parfaite. J’en donnerai deux exemples:
«il y a ces feuilles mortes qui marchent sur les vitres / leurs paumes tournées vers l’intérieur»
«La grille des pluies prison des gestes lents»
Mais la magie de l’arc-en-ciel, c’est bien connu, est rare et fugace. Le firmament est plus souvent peuplé de nuages noirs, voire d’avions de guerre. Et c’est là l’autre versant de l’œuvre de Vénus Khoury-Ghata auquel je faisais allusion tout à l’heure. La poésie n’y est pas moins intense, tant s’en faut.
Pour preuve:
«Elle portait son fardeau de brouillard par n’importe quel temps»
«La mère range les billes par ordre de taille et de tristesse / l’enfant jouera quand il sera moins mort»
«Je pense à demain cette morsure»
«La guerre pour on ne sait quelles raisons a enjambé la haie / les bombes volent dans les yeux des enfants avec les premiers flocons / dans l’école restée sur l’autre pente / les élèves conjuguent le verbe mourir au présent»
«… nous étions trois par temps de disette / Six quand la pluie ouvrait des miroirs dans le bitume et / que nous grimacions pour ne pas nous reconnaître»
«Le soleil devenait précaire / La nuit arrivait à tout moment»
«viendra un jour où même les pierres diront ce qu’elles ont sur le cœur»
Si Catherine Seylaz-Dubuis, Julien Dunilac, Jean-Dominique Humbert et moi-même avons décidé d’attribuer notre Prix au dernier recueil de poèmes de Vénus Khoury-Ghata, «Où vont les arbres?», c’est que ce livre, plus que tout autre peut-être dans son œuvre, porte à leur plus haut point toutes les qualités poétiques que j’ai précédemment évoquées.
Du reste, plus que d’un recueil, il faudrait parler d’un long poème, découpé en séquences, tant l’unité en est évidente. On pourrait dire de ce texte qu’il trouve le parfait équilibre entre narration et poésie, deux genres que l’on croyait devenus incompatibles.
Ce qui a également frappé notre Jury, c’est que ce texte dépasse les limites habituelles du simple récit ou poème pour s’élever presque au niveau du mythe. En effet, nous oscillons constamment entre une narration qui semble ancrée dans la plus stricte réalité et des envolées lyriques qui l’emportent vers d’autres horizons.
La figure dominante du livre, la mère, est à la fois, nous n’en doutons pas, la véritable mère de l’auteure, qui «parlait comme il pleut hors saison» et «se disait partie alors que c’était la route qui marchait». Mais aussi une mère mythique, démesurée, devenant une sorte d’archétype, à la fois déesse et sorcière, reine et mendiante, mère-mappemonde, mère-océan, gardienne vigilante de la mémoire universelle, celle qui «fai[t] confiance au cadran solaire non à [ses] enfants / que Dieu les corrige s’ils ont manqué une seule classe du soleil»; celle qui «… nous quittera à la jointure du sommeil dès qu’il lui poussera des enfants issus d’elle seule».
Vénus Khoury-Ghata, enfant, a passé la plupart de ses vacances chez sa tante, à Bécharré. On ne sera pas surpris d’apprendre que Khalil Gibran y est né en 1883, lui qui écrivait dans son livre inachevé «Le Jardin du Prophète»: «Car telle est la loi des marins et de la mer: si vous voulez être libres, il vous faut pénétrer dans la brume.»
Et si l’on remplace marin par poète, on comprend bien que la brume peut symboliser, sinon la nuit mystique, du moins cette existence énigmatique et souvent trouble qui est la nôtre et que le poète, telle Vénus Khoury-Ghata, sonde et interroge sans relâche.
Si l’auteur du «Prophète», émigré aux Etats-Unis, a écrit une bonne partie de ses livres en anglais, il est de nombreux autres poètes libanais du XXe siècle qui ont choisi la langue française pour faire entendre leur voix.
De Fouad Gabriel Naffah à Salah Stétié, en passant par Georges Schehadé et Fouad El-Etr, ou, du côté féminin, d’Andrée Chedid et Laurice Schehadé à Nadia Tuéni ou Nohad Salameh, autant de talents divers et personnels, mais qui ont peut-être en commun un secret qui n’appartient qu’à l’Orient, voire au Liban.
Vénus Khoury-Ghata nous en dira peut-être plus long à ce sujet puisque j’ai à présent le grand plaisir de la prier de venir me rejoindre.
Jean-Pierre Vallotton, président du Jury
2010
Lionel Ray, pour son recueil Entre nuit et soleil (Gallimard).
Soirée de remise du Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2010 à Lionel Ray pour Entre nuit et soleil, au Café-Théâtre le Bourg, à Lausanne, le 2 décembre 2010.
Parmi les quelque cinquante livres qui ont concouru au Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2010, plusieurs étaient des ouvrages de grande qualité.
Toutefois, un seul d’entre eux a recueilli tous les suffrages de notre Jury, composé de Catherine Seylaz-Dubuis, Julien Dunilac, Jean-Dominique Humbert et moi-même, et ce dès le premier tour: Entre nuit et soleil.
Son auteur, Lionel Ray, s’est déjà vu décerner de nombreux prix littéraires, dont certains prestigieux.
Etait-il dès lors bien nécessaire d’accrocher une médaille de plus au poitrail de ce valeureux poète, qui n’a plus rien à prouver depuis longtemps ? — si tant est que les poètes aient jamais cherché à prouver quoi que ce soit, et c’est sans doute là un point essentiel qui les différencie des grands savants, avec lesquels ils partagent au départ la même soif de connaissance, le même désir d’approfondir le réel, ou du moins ce que l’on suppose tel.
Seulement la question était déplacée: le livre de Lionel Ray dégageait une trop grande force poétique pour qu’on l’écartât sous un mauvais prétexte.
Par acquit de conscience, et pour respecter la procédure établie, notre Jury s’est tout de même réuni une deuxième fois pour donner une chance aux autres ouvrages sélectionnés à la fin du premier tour. Mais décidément il se passait trop de belles choses entre nuit et soleil pour que ce livre ne l’emportât point.
Ecoutez un peu et osez me dire que nous avons fait fausse route:
«le réel semble avoir été inventé ce matin avec des raffinements de primevères»,
«L’automne attend sous les arbres / dans cette lumière incomparable / des fruits obscurs»,
et ceci : «Il y a cette brûlure / au creux des mains, / l’inscription d’un vertige / qui n’a pas de nom.»,
ou encore : «Le mieux serait de n’être pas d’ici ni d’ailleurs / Mais de revivre dans l’endormissement des pierres».
Vous savez, je me pose souvent cette question: malgré le grand intérêt que l’on peut avoir pour de bons romans ou des essais philosophiques, qu’est-ce qui fait que l’on revienne toujours au poème comme à une parole essentielle?
Si j’avais une réponse catégorique à vous fournir, cela signifierait que j’aurais percé le mystère fondamental de la poésie et, franchement, c’est bien la pire des choses qui pourrait m’arriver!
Ce que je puis dire, c’est que le poème atteint parfois à ce miracle d’équilibre et de justesse entre les mots, faisant que sa force d’évocation, par sa concision même, nous touche au vif.
Ainsi ce distique de Lionel Ray:
«C’était avant le temps des ordinateurs lorsque
Les mots patientaient sous le feuillage des lampes.»
Vous comprendrez bien qu’il ne s’agit pas ici de glorifier le passéisme ou de dénigrer cet outil presque neuf qui facilite notre travail d’écrivain.
Et pourtant, comment ne pas avoir, à ses moments perdus, l’âme à la nostalgie, et se rappeler qu’il fut un temps où «Les mots patientaient sous le feuillage des lampes»?
Mais peut-on encore comprendre ce terme: patience, dans une époque qui a pris le mors aux dents, où chacun se doit de courir toujours plus vite — après qui? après quoi? Seul un poème, peut-être, pourrait nous le dire.
En relisant, ces derniers temps, la poésie de Lionel Ray, j’ai été frappé, à nouveau, par l’intensité qui se dégage de ces textes, avec leur saveur unique faite d’une apparente simplicité qui nous touche spontanément, tout en nous faisant pressentir leur part secrète, énigmatique et insaisissable. Vous voyez, cela peut sembler contradictoire et c’est pourtant ainsi. Paradoxe du poème accompli.
Mais je m’aperçois que depuis quelques minutes je vous parle d’un poète, Lionel Ray, alors que son dernier livre a été composé à quatre mains, puisque son alter ego, Laurent Barthélemy, s’est assis au clavier avec lui. Et peut-être même que quelques mots, quelques images leur auront été soufflés par un frère lointain, nommé Robert Lorho.
Trois poètes en un, alors?
Décidément, le mystère s’épaissit…
Dans un instant, notre lauréat va venir me rejoindre sur scène pour nous donner, je l’espère, quelques éclaircissements à ce sujet; mais juste avant, je voudrais ajouter encore ceci:
René Char a affirmé: «Un grand poète se remarque à la quantité de pages insignifiantes qu’il n’écrit pas.»
Eh bien croyez-moi, vous pourrez en chercher dans l’œuvre de Lionel Ray, vous n’en trouverez guère…
J’ai le grand plaisir d’accueillir Lionel Ray.
Jean-Pierre Vallotton, président du Jury
2009
Sylvestre Clancier, pour son recueil Généalogie du paysage (L’Harmattan).
Soirée de remise du Prix de Poésie Pierrette Micheloud 2009 à Sylvestre Clancier, le 3 décembre 2009, au Café-Théâtre le Bourg, à Lausanne.
C’est un grand plaisir pour moi de me retrouver (et de vous retrouver) en ces lieux pour la seconde fois cette année.
En effet, notre Grand Prix 2008 a été remis ici même à René de Obaldia, pour l’ensemble de son œuvre, le 6 février dernier.
Ces lieux (qui ont à peine changé), j’aimerais tout d’abord en dire un mot, car ils me sont particulièrement chers.
Avant de devenir ce Café-théâtre polyvalent tel que vous le connaissez, où est enregistrée notamment l’émission culturelle hebdomadaire de la TSR Tard pour bar, le Bourg était une salle de cinéma, la seule de Lausanne à avoir reçu l’appellation salle d’art et d’essai. Je ne puis évidemment me rappeler tous les films que mes amis et moi-même sommes venus voir ici, et la liste en serait trop longue.
Toutefois, en dehors de films nouveaux, presque toujours marqués du sceau de l’originalité, et ne faisant parfois qu’un passage trop furtif, tel l’incomparable Rendez-vous à Bray, de Julien Gracq et André Delvaux, ou le terrifiant Don’t look now, de Nicolas Roeg, présenté, je n’ai jamais compris pourquoi, sous le titre de En décembre à Venise (alors que son titre français officiel est bien Ne vous retournez pas), je me souviens d’avoir découvert de nombreux classiques du 7e Art, à une époque où la Cinémathèque n’était en mesure de présenter au public qu’une seule séance mensuelle. Et comment oublier ces rétrospectives consacrées aux plus grands maîtres : Bunuel, Bergman, ou encore Buster Keaton, dont on ressortait enfin pour la première fois tous les chefs-d’œuvre restaurés — et il me semble encore percevoir entre ces murs l’écho du rire homérique de mon prof de philo qui nous avait accompagnés pour l’occasion. Vous aurez évidemment compris que j’évoque des temps préhistoriques, ceux d’avant l’ère du pop-corn triomphant.
Par bonheur, l’écran est toujours là, et des projections ont encore lieu régulièrement.
J’en profite donc pour remercier une nouvelle fois toute l’équipe du Bourg de son accueil chaleureux.
Notre Jury, en portant cette année son choix sur le livre de Sylvestre Clancier Généalogie du paysage, distingue un poète à la fois discret et raffiné, complexe et accessible, qui a (je le cite) «Des yeux pour ne pas regarder / mais voir en deçà de la vie / au-delà de la mort.» Bien ancré (et encré) dans son temps, il n’a cependant jamais, à ma connaissance, cédé à la tentation des élucubrations formelles contemporaines se réclamant d’une certaine modernité (déjà un peu poussive, à vrai dire). Or il me semble que ce terme de modernité (à laquelle appelait déjà Rimbaud: «Il faut être absolument moderne», écrivait-il dans sa Saison en enfer) n’a jamais été aussi difficile à cerner qu’aujourd’hui, en ces temps de détresse sociale autant que métaphysique, face auxquels les artistes paraissent si souvent démunis.
Son credo personnel, Sylvestre Clancier l’a exprimé à plusieurs reprises, entre autres dans son recueil d’essais sur la poésie La voie des poètes: «Le poète et le philosophe que je cherche à être, les poètes que je lis et apprécie sont les anti-Lucifer, ils ne portent pas la lumière, ils la cherchent, voués au cheminement laborieux et à l’épreuve qu’est la recherche de la vérité. Elle n’est pour nous jamais acquise, nous devons la rechercher sans répit: il est toujours l’heure du travail et de la quête.»
Programme exigeant, s’il en fut! Heureusement, l’énergie de Sylvestre Clancier semble inépuisable et on le trouve présent sur tous les fronts: cherchez-le au PEN-Club français, dont il assume la présidence, et vous le découvrirez sans doute en train de s’activer au sein de la Société des Gens de Lettres. Rendez-vous à l’élégant hôtel particulier qui abrite, dans le XIVe arrondissement de Paris, cette association d’écrivains, fondée par Hugo, Balzac et consorts, et il sera probablement occupé à régler quelque affaire concernant l’Académie Mallarmé ou les Amis de Gaston Miron.
Mais où donc ce diable d’homme trouve-t-il encore le temps d’écrire ses livres! Car il en a écrit plus d’un, figurez-vous: une bonne trentaine d’ouvrages publiés à ce jour, de Profil du Songe au Livre d’Isis, en passant par L’herbier en feu et Un jardin où la nuit respire (on constatera, en passant, que ces titres sont déjà par eux-mêmes des poèmes).
S’il est un mot qui lui tient à cœur, c’est bien celui de francophonie. Car pour lui, une langue, d’autant plus lorsqu’il s’agit de poésie, ne saurait se borner aux frontières d’un pays, fût-il celui qui lui donna naissance. Sylvestre Clancier le sait mieux que quiconque: la langue dite de Molière n’appartient pas qu’aux seuls Français (et, d’ailleurs, qui pourrait se prétendre propriétaire d’une langue, quelle qu’elle soit?), mais bien à tous ceux qui, à travers le monde, l’utilisent au quotidien ou l’ont élue comme vecteur de communication. Parmi eux, de nombreux poètes, dont notre lauréat nous dit qu’ils «se sentent engagés d’une façon à la fois singulière et irréductible, qui rend vaine toute approche comparative, dans la création d’une poésie qui fait sens pour le monde entier». C’est dans cette optique qu’il fut à l’origine, en 2005, de l’association de La Nouvelle Pléiade, laquelle tend précisément à faire connaître cette «polyphonie française», par lui si joliment nommée.
L’année dernière, il a également fait partie des trois maîtres d’œuvre d’une impressionnante anthologie publiée chez Seghers, réunissant des contributions inédites de 144 poètes francophones actuels, issus des cinq continents.
A titre personnel, je tiens à ajouter que Sylvestre Clancier n’est pas seulement le poète faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit que je viens d’évoquer, mais aussi un homme simple et chaleureux, toujours prêt à accueillir l’inconnu — attitude très peu parisienne, il faut bien l’avouer. Mais sans doute est-ce dû au fait qu’il est né dans le Limousin, région évoquée ainsi dans Généalogie du paysage: «Pays où souvent tu reviens / et dont tu aimes les fougères / qui fait que tu te souviens / des premier instants de lumière.» Cette contrée qui lui est si chère, et où il retourne régulièrement se ressourcer, à mi-chemin entre Paris et Toulouse, est au cœur de l’ouvrage que notre Jury a décidé de couronner. Cette terre qui vit naître la langue d’oc, que portèrent à son apogée de célèbres troubadours du XIIe siècle, tels Bernard de Ventadour ou Bertran de Born, lequel écrivait déjà, en parlant du Limousin: «Un petit jardin ici / Vaut plus qu’un trésor / En terre étrangère».
Mais pour en savoir davantage sur ce livre et son auteur, je vous propose d’accueillir à présent Sylvestre Clancier.
Jean-Pierre Vallotton, président du Jury
Son don d’écoute et de générosité envers autrui était rare et délicat. Toutes celles et tous ceux qui l’ont connue peuvent en témoigner.
Pierrette Micheloud avait le sens de la fraternité et de la tolérance, elle s’était donnée très jeune à sa passion pour la poésie et la marche, proche en cela de son grand aîné Jean-Jacques Rousseau, elle allait de village en village, de café en cabarets ou salles publiques pour dire et conter, faire œuvre utile en faisant partager ses lectures, en donnant à entendre ses propres créations.
Elle aimait par-dessus tout son pays et ses hommes, la Suisse romande et son Valais natal en particulier. Elle aimait s’y retrouver en compagnie de sa sœur et de son neveu, musiciens tous les deux, sur les hauteurs, non loin de la source du Rhône, ce fleuve qui est l’âme de la Suisse romande qu’il fleurit de ses eaux qui s’étendent en un lac majestueux devant Lausanne et les hauteurs de Belmont où, chaque été, Pierrette aimait se reposer dans son chalet.
Mais, Pierrette Micheloud vouait également un culte singulier au Paris de Saint-Germain-des-Prés où elle avait un charmant pied-à-terre, sorte de chalet suisse en miniature.
Mon propre goût pour Saint-Germain-des-Prés et les rives du Léman faisait que nous nous voyions souvent et que nous en étions enchantés.
J’aimais aussi me rendre aux invitations de Pierrette, lorsque celle-ci nous montrait ses tableaux dans quelque galerie parisienne, car, non contente d’être un grand poète, Pierrette avait aussi un grand talent de peintre. J’aimais notamment retrouver dans ses toiles sa fantaisie inspirée ainsi que son goût pour les symboles, voire l’alchimie qui imprégnait aussi certains de ses poèmes.
La poésie de Pierrette est si lumineuse et intense à la fois, elle nous transmet un don de voir et de sentir la nature au plus profond d’elle-même, que je me suis toujours senti, de par mes propres goûts et centres d’intérêt, en parfaite harmonie avec cette œuvre hautement inspirée.
J’avais eu grand plaisir à faire publier l’un de ses livres, Azoth, chez l’un de mes amis éditeurs, les éditions Proverbe, dirigées par Jérôme Vérain, où elle se trouvait en bonne compagnie entre Jean Lescure, Paul-Emile Victor et Frédéric Jacques Temple. J’avais eu plaisir également à lui remettre voici quelques années, au tournant du siècle, à la Société des Gens de Lettres de France, le prix de poésie Charles Vildrac, à l’occasion de la parution d’une anthologie de ses poèmes parue précédemment à L’Âge d’homme.
Voici que j’ai aujourd’hui le même plaisir à être honoré par ses amis poètes qui ont formé le jury du Prix de la Fondation Pierrette Micheloud.
Cette fondation a une vocation qui ne peut que nous enthousiasmer, puisque Pierrette était l’une de mes très chères amies et une artiste de grand talent. Il s’agit de perpétuer son œuvre qui est considérable: elle a publié une vingtaine de volumes sur une période de plus de soixante ans. En 1945, en effet, paraît son premier recueil, Saisons, et, en 2006, son récit autobiographique, Nostalgie de l’innocence, aux éditions de L’Aire.
Je suis d’autant plus touché que je reçois cette distinction pour un recueil dans lequel je pense avoir mis toute mon âme d’enfance et mon attachement singulier au pays de mes pères et de mes ancêtres.
Dans Généalogie du paysage, je dis, en effet, sous la forme de quatrains, comme l’avait fait Rilke, poète que j’admire, pour le Valais qu’il chérissait, tout ce que je dois au Limousin de mon enfance.
Sylvestre Clancier